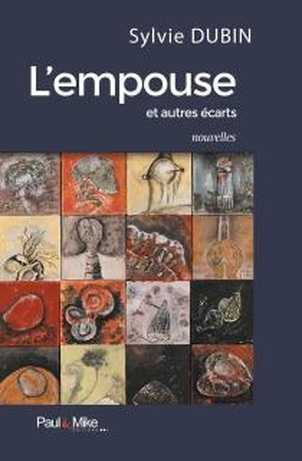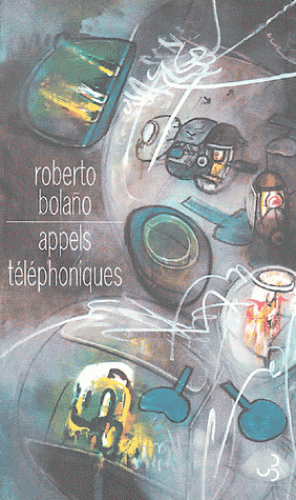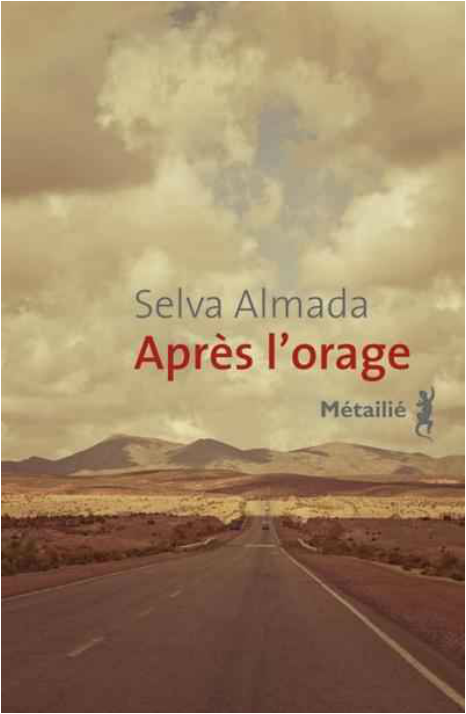S’il est un genre littéraire qui va comme un gant à l’auteure de cet ouvrage, c’est précisément celui de la nouvelle.
Car Martine Paulais a deux cordes à son arc : elle publie des nouvelles (sous le pseudonyme d’Eve Roland) et anime des ateliers d’écriture où elle met régulièrement à l’honneur ce genre littéraire. C’est donc forte de cette double expérience qu’elle s’adresse, avec cet livre, aux nouvellistes en devenir – et pourquoi pas aux auteurs déjà un peu plus aguerris –, pour leur faire prendre conscience des ingrédients principaux qui entrent dans la composition de ce genre, et leur présenter les outils qui leur permettront d’écrire des nouvelles efficaces.
Ce petit ouvrage au format poche sera de fait bien utile à ceux qui, souhaitant dépasser la simple écriture spontanée de la nouvelle et ne se laissant pas piéger par les sirènes du premier jet, souhaitent peaufiner leurs techniques de construction et d’écriture de nouvelles.
Publié dans la collection « Guides pratiques » des éditions Enviedécrire, c’est bien d’un ouvrage pratique qu’il s’agit. Point trop de théorie ni d’excès de jargon narratologique savant, mais un décorticage précis et progressif des différentes étapes à mettre en œuvre pour produire une nouvelle bien huilée.
L’ouvrage a pour qualités d’être précis et concret. Il met entre autres en lumière les questions à se poser avant de se lancer dans l’écriture, la manière de poser les fondations d’une intrigue, de bâtir des personnages crédibles, de choisir le point de vue narratif le plus efficace par rapport au projet de la nouvelle, de trouver une chute surprenante et bien amenée, etc. Le propos est illustré d’analyses de textes d’auteurs reconnus, qu’ils soient classiques ou plus contemporains, Martine Paulais rendant par là même justice à la diversité du genre et proposant au lecteur de s’éloigner des sentiers battus de la classique nouvelle à chute pour explorer les voies plus intimistes de la nouvelle d’atmosphère. On y trouvera également des consignes d’écriture permettant de se frotter à quelques-unes des questions techniques posées par le genre, des informations sur les circuits éditoriaux de la nouvelle, des témoignages d’auteurs sur leurs propres pratiques d’écriture.
Ne reste plus aux amateurs d’écriture de nouvelles qu'à saisir ce petit guide d’une main et leur carnet de notes de l’autre, et à assembler les différentes pièces de cet amusant jeu de mécano !
(Martine Paulais, Comment écrire…. une nouvelle, Enviedécrire Éditions, 2019, 178 p., 18€)
Olivia Guérin
Aix Marseille Univ, CNRS, LPL, Aix-en-Provence, France.

OUBLIE LES FEMMES, MAURICE
Florent Jaga
Editions Quadrature
Florent Jaga ou l’amour vache
Chez Florent Jaga, l’amour n’est pas une sinécure. Dans les couples qui sont au cœur du recueil Oublie les femmes, Maurice, ça se chamaille, ça se déteste, ça se méprise, ça s’étripe, ça cherche de temps à autre à se zigouiller. Et parfois – parfois seulement –, ça se rabiboche.
Les quatorze nouvelles qui forment ce recueil constituent au premier chef une galerie de portraits contemporains d’une agréable causticité. On y croise, entre autres, des filles exhibitionnistes, des pin ups, une belle brochette de frustrés, des voyeurs, un pompier tueur en série, un prêtre amoureux d’une effrontée, et surtout beaucoup de couples déglingués qui se dédaignent ou s’indiffèrent. Ces personnages s'observent les uns les autres (« Je suis resté à la bière et j’ai bu tranquillement en laissant mon regard trainer sur la vie des autres »), à l’instar du narrateur, qui se fait un malin plaisir à croquer les petits travers de ses contemporains.
Autant dire que les rapports homme-femme ne sont pas des plus lisses au sein de cette incroyable clique de personnages cabossés ! L’auteur dénonce leurs tromperies, leurs haines, la violence des rapports homme-femme. Ici, l’amour est fait de cicatrices, de blessures, de vexations. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Florent Jaga est un anti-romantique.
Autant la vision du monde est cynique, autant l’écriture est alerte. Si Jaga file volontiers la métaphore, elle se veut précisément anti-poétique : l’auteur s’amuse à détourner les clichés poétiques, comme dans cette rapide description de l’océan : « J’ai vidé le reste de la canette d’un trait et je me suis dirigé vers l’océan. Il était déchainé. L’écume giclait mieux que la sueur d’un métalleux à un concert d’AC/DC ».
Jaga maitrise l’art de la nouvelle avec maestria. Parfois construites en diptyques, alternant de temps à autre les points de vue, les nouvelles qui constituent ce recueil sont souvent construites sur un jeu de retournement, rappelant le motif de l’arroseur arrosé. L’amour est ici conçu comme un jeu de domination où les rapports de force peuvent subitement s’inverser.
Et tout cela est joyeusement irrévérencieux, agréablement sarcastique, parfois loufoque et décalé. En bref, Florent Jaga nous offre là un moment de lecture disons… revigorant !
Florent Jaga, Oublie les femmes, Maurice , Editions Quadrature, octobre 2019, ISBN 978-2-930538-94-5, 115p., 16€
Olivia Guérin
Aix Marseille Univ, CNRS, LPL, Aix-en-Provence, France.
Florent Jaga
Editions Quadrature
Florent Jaga ou l’amour vache
Chez Florent Jaga, l’amour n’est pas une sinécure. Dans les couples qui sont au cœur du recueil Oublie les femmes, Maurice, ça se chamaille, ça se déteste, ça se méprise, ça s’étripe, ça cherche de temps à autre à se zigouiller. Et parfois – parfois seulement –, ça se rabiboche.
Les quatorze nouvelles qui forment ce recueil constituent au premier chef une galerie de portraits contemporains d’une agréable causticité. On y croise, entre autres, des filles exhibitionnistes, des pin ups, une belle brochette de frustrés, des voyeurs, un pompier tueur en série, un prêtre amoureux d’une effrontée, et surtout beaucoup de couples déglingués qui se dédaignent ou s’indiffèrent. Ces personnages s'observent les uns les autres (« Je suis resté à la bière et j’ai bu tranquillement en laissant mon regard trainer sur la vie des autres »), à l’instar du narrateur, qui se fait un malin plaisir à croquer les petits travers de ses contemporains.
Autant dire que les rapports homme-femme ne sont pas des plus lisses au sein de cette incroyable clique de personnages cabossés ! L’auteur dénonce leurs tromperies, leurs haines, la violence des rapports homme-femme. Ici, l’amour est fait de cicatrices, de blessures, de vexations. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Florent Jaga est un anti-romantique.
Autant la vision du monde est cynique, autant l’écriture est alerte. Si Jaga file volontiers la métaphore, elle se veut précisément anti-poétique : l’auteur s’amuse à détourner les clichés poétiques, comme dans cette rapide description de l’océan : « J’ai vidé le reste de la canette d’un trait et je me suis dirigé vers l’océan. Il était déchainé. L’écume giclait mieux que la sueur d’un métalleux à un concert d’AC/DC ».
Jaga maitrise l’art de la nouvelle avec maestria. Parfois construites en diptyques, alternant de temps à autre les points de vue, les nouvelles qui constituent ce recueil sont souvent construites sur un jeu de retournement, rappelant le motif de l’arroseur arrosé. L’amour est ici conçu comme un jeu de domination où les rapports de force peuvent subitement s’inverser.
Et tout cela est joyeusement irrévérencieux, agréablement sarcastique, parfois loufoque et décalé. En bref, Florent Jaga nous offre là un moment de lecture disons… revigorant !
Florent Jaga, Oublie les femmes, Maurice , Editions Quadrature, octobre 2019, ISBN 978-2-930538-94-5, 115p., 16€
Olivia Guérin
Aix Marseille Univ, CNRS, LPL, Aix-en-Provence, France.

L'ETRANGE AFFAIRE DU PANTALON DE DASSOUKINE
Fouad Laroui
Le prix Goncourt de la nouvelle a fort opportunément récompensé en mai 2013 L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine, un recueil de nouvelles original à la fois drôle et profond, tendre et grave et d’une grande inventivité d’écriture.
Fouad Laroui ne se contente pas en effet d’y déboulonner les codes et les clichés et d’y dénoncer le culte des apparences en mettant en scène de courtes histoires quotidiennes, illustrant l’absurdité du monde au travers de situations cocasses et de chutes inattendues. Il s’attache surtout à y mettre en scène le langage, disloquant sa cohérence de surface, ses automatismes rassurants, creusant de multiples décalages langagiers en jouant sur les sons et les graphies comme sur l’ambiguïté du sens des mots, sur la variété des langues et les anachronismes, utilisant les ressources de la ponctuation, des incises et des caractères italiques, désarticulant la syntaxe, brouillant l’identité narrative et imbriquant sans cesse dialogues et monologues…
Une déstructuration protéiforme foisonnante et décapante de la langue menée le plus souvent sur un rythme endiablé – même si l’auteur aime les digressions – et enrichie d’un recours abondant, érudit mais aussi très éclectique, à l’intertextualité qui vient renforcer le comique de ces nouvelles et l’épaisseur philosophique du propos qui les sous-tend.
D’emblée cet écrivain marocain de langue et de culture française, connaissant bien l’Angleterre et les Pays-Bas où il vit depuis plusieurs années, donne le ton dans l’incipit de la nouvelle éponyme ouvrant son recueil :
« La Belgique est bien la patrie du surréalisme… »
Un incipit énoncé par le héros narrateur Dassoukine (1), haut fonctionnaire envoyé par le Maroc à Bruxelles pour négocier l’achat de blé pour son pays, et commenté ironiquement par son interlocuteur – et également narrateur – qui semble une sorte de double de l’auteur prenant un recul ironique sur son texte et témoignant de son travail d’écriture :
« En présence d’un incipit que faire ? »
Que faire sinon « attendre la suite, résigné » : une suite confirmant que ce livre est bien placé sous le signe de ce petit pays jouxtant la France et les Pays-Bas, dont le peuple est séparé par deux langues et surtout deux cultures de tradition chrétienne et calviniste, source d’incompréhensions. De cette Belgique dont la peinture et la littérature francophone accompagnèrent largement le mouvement surréaliste.
Dans ce recueil, Fouad Laroui porte un regard de poète sur l’étrangeté des situations les plus quotidiennes, traquant l’absurde au travers du langage à l’instar de Raymond Queneau, cofondateur de l’Oulipo (2) auquel il s’amuse à envoyer de nombreux clins d’œil, sans doute pour nous « esspliquer » cette sorte de filiation « avunculaire » qui les relie. Et ce qui semble évident « à c’t’heure », c’est que posséder à fond plusieurs langues et plusieurs cultures avec toutes les connotations interprétatives qu’elles recèlent, comme les Belges et plus encore comme l’auteur, peut permettre aussi de porter un regard plus libre sur le monde et de développer une pensée plus autonome.
Dans trois nouvelles, les héros sont des exilés – plus ou moins temporaires – qui se retrouvent ainsi à Bruxelles, ou à Utrecht pour l’une d’entre elles. L’auteur y aborde ces « incompréhensions culturelles » apparemment dérisoires dont l’accumulation dégrade fortement les rapports entre les individus, qu’il s’agisse d’un haut fonctionnaire marocain et de ses homologues européens ou de ces couples mixtes (Marocain et Néerlandaise, ou Néerlandais et Française) vivant pourtant une relation amoureuse égalitaire. Et les deux nouvelles sur ces couples mixtes qui fascinent tant l’auteur se terminent malgré tout sur une note d’espoir, les « gestes » de tendresse venant pallier les difficultés de communication.
Quatre autres s’intéressent plus largement au chaos du monde dont elles explorent les étranges lois sur le territoire marocain, partant pour trois d’entre elles d’un certain Café de l’Univers (3) de Casablanca où plusieurs amis se réunissent pour discuter en interprétant ou en refaisant le monde…
Un café évoquant encore malicieusement la Belgique au travers de Claude Semal, ce Belge à la coiffure de Tintin, chanteur, comédien et auteur comique, sorte de clown roi de l’absurde et chantre de la belgitude à la chanson duquel renvoie également l’avant-dernière nouvelle qui semble clore ce recueil sur un petit sketch philosophico-théâtral lui rendant hommage.
Quant à la neuvième et très courte nouvelle, on peut la considérer comme une sorte d’épilogue rattachant ce recueil à l’actualité des Printemps arabes : des rêves d’avenir qui semblent masquer le cauchemar du passé en rétablissant le conformisme mensonger de l’apparence. L’auteur semblant ainsi se montrer plus pessimiste sur un plan collectif.
Un livre réjouissant à ne pas manquer !
Emmanuelle Caminade
(Article initialement paru dans La cause littéraire)
(1) Reprenant le nom d’un célèbre humoriste marocain auquel l’auteur rend hommage
(2) L’OUvroir de LIttérature Potentielle, groupe international de littéraires et de mathématiciens auquel l’auteur ne se sent manifestement pas étranger
3) Le Café de l’Univers, chanson de Claude Semal, dernier couplet :
« Puisqu’il faut partir un jour
Par la porte ou la fenêtre
Pour ce voyage au long cours
Au pays d’avant de naître
Au Café de l’Univers
Voici ma chaise et ma table
Mes mots dans un revolver
Continuez le spectacle ! »
A propos de l'écrivain Fouad Laroui est né en 1958 à Oujda. Après de brillantes études au lycée français de Casablanca, il intègre l’école nationale des Ponts et Chaussées en France et en sort ingénieur. Il dirige une usine de phosphates puis quitte le Maroc, fait des études de sciences économiques, enseigne l’économie en Angleterre, en France, et aux Pays-Bas. Il vit actuellement à Amsterdam où, après avoir donné des cours de culture arabe, il enseigne désormais la littérature française et francophone à l’université tout en se consacrant à l’écriture. Il est l’auteur de nombreux livres (essais, récits, romans et nouvelles, albums jeunesse, et même un recueil de poésies écrit en néerlandais) dont plusieurs ont été primés.

MARIE VENTURA ET LE NEUVIEME ROYAUME
Sylvia Plath
Editions Gallimard
En 1952, Sylvia Plath, vingt ans, écrivait une nouvelle que publie enfin La Table Ronde, dans sa version d’origine (refusée pour noirceur alors). C’est une nouvelle terrifiante. Mary Ventura et le neuvième royaume nous plonge dans un voyage ferroviaire de pure terreur. Le train serait-il celui de la vie, et le trajet sans retour ? Mary, quoique réticente, prend, à l’invite de ses parents, le train. « Un voyage de formalité » dira la mère. Mary se dit « non prête pour le voyage ».
Le lecteur comprendra très vite que son personnage est mal embarqué, et les situations décrites, les dialogues, l’enjoignent à prêter une attention vive à ce qui se déroule, selon le rythme d’une machinerie infernale. L’air de rien, l’auteure, jeune, instille un malaise qui ne fera que croître, station après station, « royaume après royaume ». On évoque la noirceur des tunnels, l’improbable retour, les fenêtres du train s’émaillent de drôles de figures.
La surprise sera-t-elle au bout de la route ? Ou la méprise ? L’art de la jeune romancière est d’inscrire une réflexion philosophique sur la trame du voyage : la vie, la mort, l’autre, le destin sont autant de stations que tout esprit rameute.
Dans la mouvance d’écrits assez noirs des années quarante (Orwell), Sylvia Plath s’inscrit aussi dans une littérature du péril : où allons-nous, en cette société ? Droit dans le mur des évidences ? Comme des voyageurs apeurés, menés à la baguette, comme un troupeau d’âmes déjà mortes ? La nouvelle, en tout cas, vibre de cette tension palpable, d’une existence sans cesse remise en question par les bouleversements d’un monde incertain.
Sylvia Plath, Mary Ventura et le neuvième royaume, mai 2019, trad. anglais Anouk Neuhoff, 48 pages, 5 €
A propos de l’écrivain : Sylvia Plath, née le 27 octobre 1932 à Jamaica Plain, dans la banlieue de Boston, et morte le 11 février 1963 à Londres, est un écrivain américain ayant produit essentiellement des poèmes, mais aussi un roman, des nouvelles, des livres pour enfants et des essais. Si elle est surtout connue en tant que poète, elle tire également sa notoriété de The Bell Jar (en français, La Cloche de détresse), roman d'inspiration autobiographique qui décrit en détail les circonstances de sa première dépression, au début de sa vie d'adulte.
Depuis son suicide en 1963, Sylvia Plath est devenue une figure emblématique dans les pays anglo-saxons, les féministes voyant dans son œuvre l'archétype du génie féminin écrasé par une société dominée par les hommes, les autres voyant en elle une icône dont la poésie, en grande partie publiée après sa mort, fascine comme la bouleversante chronique d'un suicide annoncé.
Philippe Leuckx
(Article paru dans La cause littéraire)
Sylvia Plath
Editions Gallimard
En 1952, Sylvia Plath, vingt ans, écrivait une nouvelle que publie enfin La Table Ronde, dans sa version d’origine (refusée pour noirceur alors). C’est une nouvelle terrifiante. Mary Ventura et le neuvième royaume nous plonge dans un voyage ferroviaire de pure terreur. Le train serait-il celui de la vie, et le trajet sans retour ? Mary, quoique réticente, prend, à l’invite de ses parents, le train. « Un voyage de formalité » dira la mère. Mary se dit « non prête pour le voyage ».
Le lecteur comprendra très vite que son personnage est mal embarqué, et les situations décrites, les dialogues, l’enjoignent à prêter une attention vive à ce qui se déroule, selon le rythme d’une machinerie infernale. L’air de rien, l’auteure, jeune, instille un malaise qui ne fera que croître, station après station, « royaume après royaume ». On évoque la noirceur des tunnels, l’improbable retour, les fenêtres du train s’émaillent de drôles de figures.
La surprise sera-t-elle au bout de la route ? Ou la méprise ? L’art de la jeune romancière est d’inscrire une réflexion philosophique sur la trame du voyage : la vie, la mort, l’autre, le destin sont autant de stations que tout esprit rameute.
Dans la mouvance d’écrits assez noirs des années quarante (Orwell), Sylvia Plath s’inscrit aussi dans une littérature du péril : où allons-nous, en cette société ? Droit dans le mur des évidences ? Comme des voyageurs apeurés, menés à la baguette, comme un troupeau d’âmes déjà mortes ? La nouvelle, en tout cas, vibre de cette tension palpable, d’une existence sans cesse remise en question par les bouleversements d’un monde incertain.
Sylvia Plath, Mary Ventura et le neuvième royaume, mai 2019, trad. anglais Anouk Neuhoff, 48 pages, 5 €
A propos de l’écrivain : Sylvia Plath, née le 27 octobre 1932 à Jamaica Plain, dans la banlieue de Boston, et morte le 11 février 1963 à Londres, est un écrivain américain ayant produit essentiellement des poèmes, mais aussi un roman, des nouvelles, des livres pour enfants et des essais. Si elle est surtout connue en tant que poète, elle tire également sa notoriété de The Bell Jar (en français, La Cloche de détresse), roman d'inspiration autobiographique qui décrit en détail les circonstances de sa première dépression, au début de sa vie d'adulte.
Depuis son suicide en 1963, Sylvia Plath est devenue une figure emblématique dans les pays anglo-saxons, les féministes voyant dans son œuvre l'archétype du génie féminin écrasé par une société dominée par les hommes, les autres voyant en elle une icône dont la poésie, en grande partie publiée après sa mort, fascine comme la bouleversante chronique d'un suicide annoncé.
Philippe Leuckx
(Article paru dans La cause littéraire)
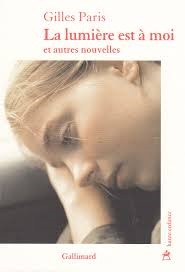
LA LUMIERE EST A MOI ET AUTRES NOUVELLES
Gilles Paris
Gallimard, 2018
La sensualité adolescente retrouvée. Deux garçons pour une fille. L’été comme un frisson.
Dans la langue, on renoue avec l’intime, cette « lumière est à moi », nous suggère le titre, celle du corps, du cœur, et de ce touché d’une cible si difficile à nommer quand elle vibre au loin à l’intérieur.
Du surplomb de l’enfance – au sens large, petite et adolescence –, Gilles Paris découvre des consciences fines.
La grâce de l’écriture fait le reste.
La longue nouvelle, Eytan, qui déroule ses errances et beautés relationnelles sur les îles Lipari, surtout, comme « Les enfants de chœur ».
Beaucoup de poésie, d’âpreté. Nombre de regards d’adolescents, de jeunes filles, légèrement en décalage, avec une perception aiguë des adultes qui virevoltent autour d’eux.
L’auteur, la soixantaine récente, renoue avec l’été, l’enfance, ce lointain en nous juste rattrapable.
Le monde de l’enfance est un étrange espace d’imagination, en éveil ou en péril. On peut y mentir, édifier des rêves de famille, faire vivre ou mourir, concevoir des fêtes, relever des défis. Dans certaines de ces nouvelles, où il est beaucoup question de géniteurs plus ou moins agréables, plus ou moins consentants, plus ou moins adultes, les objets ont une âme, les arbres parlent, et « la lumière est à moi » tient sans doute du miracle de l’enfant qui sent soudain la vie refaire surface.
Gilles Paris déroule la vie telle que la société la propose, avec ses familles éclatées, ses papas et mamans en quête de bonheur, ses enfants, au demeurant, souvent témoins de ce qui les dépasse, enfants et adolescents destinés sans doute à mûrir plus vite dans un monde qui bouge, change, déroute.
Entre âpreté et descriptions poétiques de villégiatures, de milieux protégés, l’écriture de Gilles Paris cerne la beauté qui souffre, l’attente, le rêve, l’imaginaire fécond des enfants que nous sommes restés, perdus et égarés, à l’aune de la vie « faite de rencontres surprenantes ».
Gilles Paris, La lumière est à moi, et autres nouvelles, Gallimard coll. Haute enfance, octobre 2018, 208 pages, 19 €
A propos de l’écrivain : Né à Suresnes en 1959, Gilles Paris est un écrivain français. Son premier roman, Papa et Maman sont morts (Le Seuil, 1991), a été adapté au cinéma, et le suivant, Autobiographie d’une Courgette (Plon, 2001), a été traduit en plusieurs langues et a fait l’objet de plusieurs adaptations, télévisuelle (2007) et cinématographique (2015).
Philippe Leuckx
(Article paru dans La Cause Littéraire)
Gilles Paris
Gallimard, 2018
La sensualité adolescente retrouvée. Deux garçons pour une fille. L’été comme un frisson.
Dans la langue, on renoue avec l’intime, cette « lumière est à moi », nous suggère le titre, celle du corps, du cœur, et de ce touché d’une cible si difficile à nommer quand elle vibre au loin à l’intérieur.
Du surplomb de l’enfance – au sens large, petite et adolescence –, Gilles Paris découvre des consciences fines.
La grâce de l’écriture fait le reste.
La longue nouvelle, Eytan, qui déroule ses errances et beautés relationnelles sur les îles Lipari, surtout, comme « Les enfants de chœur ».
Beaucoup de poésie, d’âpreté. Nombre de regards d’adolescents, de jeunes filles, légèrement en décalage, avec une perception aiguë des adultes qui virevoltent autour d’eux.
L’auteur, la soixantaine récente, renoue avec l’été, l’enfance, ce lointain en nous juste rattrapable.
Le monde de l’enfance est un étrange espace d’imagination, en éveil ou en péril. On peut y mentir, édifier des rêves de famille, faire vivre ou mourir, concevoir des fêtes, relever des défis. Dans certaines de ces nouvelles, où il est beaucoup question de géniteurs plus ou moins agréables, plus ou moins consentants, plus ou moins adultes, les objets ont une âme, les arbres parlent, et « la lumière est à moi » tient sans doute du miracle de l’enfant qui sent soudain la vie refaire surface.
Gilles Paris déroule la vie telle que la société la propose, avec ses familles éclatées, ses papas et mamans en quête de bonheur, ses enfants, au demeurant, souvent témoins de ce qui les dépasse, enfants et adolescents destinés sans doute à mûrir plus vite dans un monde qui bouge, change, déroute.
Entre âpreté et descriptions poétiques de villégiatures, de milieux protégés, l’écriture de Gilles Paris cerne la beauté qui souffre, l’attente, le rêve, l’imaginaire fécond des enfants que nous sommes restés, perdus et égarés, à l’aune de la vie « faite de rencontres surprenantes ».
Gilles Paris, La lumière est à moi, et autres nouvelles, Gallimard coll. Haute enfance, octobre 2018, 208 pages, 19 €
A propos de l’écrivain : Né à Suresnes en 1959, Gilles Paris est un écrivain français. Son premier roman, Papa et Maman sont morts (Le Seuil, 1991), a été adapté au cinéma, et le suivant, Autobiographie d’une Courgette (Plon, 2001), a été traduit en plusieurs langues et a fait l’objet de plusieurs adaptations, télévisuelle (2007) et cinématographique (2015).
Philippe Leuckx
(Article paru dans La Cause Littéraire)

LE DELIRANT ESPRIT DE FAMILLE
Valério Romao
Editions Chandeigne
La famille chez Valério Romao ressemble à l’enfer de Jérome Bosch où se promènent poissons-oiseaux, têtes humaines sans corps, hommes-arbres, souris-cheval. Un enfer qui, loin d’être morbide ou désespéré, se révèle aussi fou et enivrant qu’un carnaval ou une bacchanale. Sous l’angle de la métamorphose, cet écrivain portugais met en scène l’envers surréaliste des tares et atavismes ordinaires des familles.
Chaque nouvelle du recueil De la famille nous plonge à l’intérieur de l’oeil du cyclone familial où pleuvent les coups du destin - pauvreté, dépression, mort, maladie, alcoolisme, divorce, disputes, inondations. Mais grâce au point de vue poétique des narrateurs, ces malheurs au lieu d’abattre et tuer déclenchent une série de transformations dont l’auteur s’amuse à tirer le fil jusqu’à l’absurde et le fantastique.
Le narrateur enfant raconte dans Quand papa s’est mis à crever comment l’ingestion excessive de vin a gonflé le corps de son père jusqu’à le faire enfler comme un ballon et flotter jusqu’au plafond. Grâce à l’amour de son petit-fils, dans Peu à peu on a oublié grand-mère, la grand-mère atteinte d’Alzheimer se transforme rien que pour lui en une mère idéale et une jeune danseuse. Le regard de l’enfant angoissé et fiévreux (L’abime te regarde aussi longuement) transforme ses parents en couple satanique qui jette leurs invités dans un puits de flammes. Chassé par le père, le fils de Lorsqu’on a jeté mon frère dehors revient hanter le reste de la famille sous les traits d’un reflet derrière une fenêtre. Quand mon grand-père était le seul qui avait des branchies, en plus des poumons : alors qu’en plein déluge ils sont coincés au grenier de leur maison sans nourriture, le grand-père, grâce à des branchies gagnées lors d’un concours télévisé, se fait poisson, plonge sous l’eau et leur pêche de quoi survivre. Dans Sur la physique des particules…, suite à une chute, Rogério, deux ans et demi, se multiplie et se duplique en paire de jumeaux…
Dans la famille vue par Valerio Romao, on ne meurt pas, on mute, on se transforme, on devient un autre - c’est faire le choix de la folie contre le néant. Dans la magnifique nouvelle A mesure que nous avons récupéré maman, le frère aîné, pour aider son père inconsolable depuis la mort de son épouse, se met à imiter la mère disparue, sa voix, ses gestes, son esprit, jusqu’à, grâce au travestissement, devenir elle. Dans la dernière nouvelle, un serial-killer enlève des enfants, les séquestre et les dissèque au bistouri pour « essayer de trouver sous leur peau les traits de Rogério ou de Rita », ses enfants disparus. Une autre manière de suggérer que les figures familiales, même décédées, hantent pour toujours l’esprit de chacun.
Ces silhouettes monstrueuses sont d’autant plus impressionnantes qu’elles se dessinent sur un arrière-plan parfaitement réaliste et contemporain, rythmé par les sessions télé séries-jeu-journal, les repas de famille et les sorties au parc. Le souffle oral des monologues intérieurs, le ton analytique qui contraste avec l’absurde et la démesure de ce qui est décrit, la phrase qui dévale les lignes en cascade, se brise soudainement et retrouve un élan au paragraphe suivant, et surtout les surprenantes, et cocasses, métaphores qui transforme un poisson congelé en « sardine jurassique », un enfant en « fragile sapin malade », le chaos familial en « safari de bains et de dîners », font de ce livre un trésor baroque à découvrir de toute urgence.
Géraldine Doutriaux
De la famille de Valério Romao
Editions Chandeigne
176 pages 71 euros
Valério Romao
Editions Chandeigne
La famille chez Valério Romao ressemble à l’enfer de Jérome Bosch où se promènent poissons-oiseaux, têtes humaines sans corps, hommes-arbres, souris-cheval. Un enfer qui, loin d’être morbide ou désespéré, se révèle aussi fou et enivrant qu’un carnaval ou une bacchanale. Sous l’angle de la métamorphose, cet écrivain portugais met en scène l’envers surréaliste des tares et atavismes ordinaires des familles.
Chaque nouvelle du recueil De la famille nous plonge à l’intérieur de l’oeil du cyclone familial où pleuvent les coups du destin - pauvreté, dépression, mort, maladie, alcoolisme, divorce, disputes, inondations. Mais grâce au point de vue poétique des narrateurs, ces malheurs au lieu d’abattre et tuer déclenchent une série de transformations dont l’auteur s’amuse à tirer le fil jusqu’à l’absurde et le fantastique.
Le narrateur enfant raconte dans Quand papa s’est mis à crever comment l’ingestion excessive de vin a gonflé le corps de son père jusqu’à le faire enfler comme un ballon et flotter jusqu’au plafond. Grâce à l’amour de son petit-fils, dans Peu à peu on a oublié grand-mère, la grand-mère atteinte d’Alzheimer se transforme rien que pour lui en une mère idéale et une jeune danseuse. Le regard de l’enfant angoissé et fiévreux (L’abime te regarde aussi longuement) transforme ses parents en couple satanique qui jette leurs invités dans un puits de flammes. Chassé par le père, le fils de Lorsqu’on a jeté mon frère dehors revient hanter le reste de la famille sous les traits d’un reflet derrière une fenêtre. Quand mon grand-père était le seul qui avait des branchies, en plus des poumons : alors qu’en plein déluge ils sont coincés au grenier de leur maison sans nourriture, le grand-père, grâce à des branchies gagnées lors d’un concours télévisé, se fait poisson, plonge sous l’eau et leur pêche de quoi survivre. Dans Sur la physique des particules…, suite à une chute, Rogério, deux ans et demi, se multiplie et se duplique en paire de jumeaux…
Dans la famille vue par Valerio Romao, on ne meurt pas, on mute, on se transforme, on devient un autre - c’est faire le choix de la folie contre le néant. Dans la magnifique nouvelle A mesure que nous avons récupéré maman, le frère aîné, pour aider son père inconsolable depuis la mort de son épouse, se met à imiter la mère disparue, sa voix, ses gestes, son esprit, jusqu’à, grâce au travestissement, devenir elle. Dans la dernière nouvelle, un serial-killer enlève des enfants, les séquestre et les dissèque au bistouri pour « essayer de trouver sous leur peau les traits de Rogério ou de Rita », ses enfants disparus. Une autre manière de suggérer que les figures familiales, même décédées, hantent pour toujours l’esprit de chacun.
Ces silhouettes monstrueuses sont d’autant plus impressionnantes qu’elles se dessinent sur un arrière-plan parfaitement réaliste et contemporain, rythmé par les sessions télé séries-jeu-journal, les repas de famille et les sorties au parc. Le souffle oral des monologues intérieurs, le ton analytique qui contraste avec l’absurde et la démesure de ce qui est décrit, la phrase qui dévale les lignes en cascade, se brise soudainement et retrouve un élan au paragraphe suivant, et surtout les surprenantes, et cocasses, métaphores qui transforme un poisson congelé en « sardine jurassique », un enfant en « fragile sapin malade », le chaos familial en « safari de bains et de dîners », font de ce livre un trésor baroque à découvrir de toute urgence.
Géraldine Doutriaux
De la famille de Valério Romao
Editions Chandeigne
176 pages 71 euros

SANGUINES
Pascale Dujol
Editions Quadrature
Sanguines de Pascale Pujol est une variation autour du motif écarlate, universel et pourtant tabou, du sang. Tabou parce qu’il ne s’agit pas du sang héroïque ou pathétique de la blessure ou de la maladie, mais de celui sans concession, voire repoussant, des menstruations. Il irrigue tout le recueil et tel un talisman rouge, maléfique ou bénéfique, il irradie au coeur de chaque nouvelle. L’auteur décline et crée des histoires autour de tout ce qu’évoque dans l’imaginaire ce sang métonymie du féminin.
Ainsi il est de manière attendue dans Le passage le symbole de la puberté et du passage à l’âge adulte pour Margaux que la venue des règles va éloigner de sa mère. Plus original, la nouvelle Lady Net montre un héros, dont le métier consiste à jeter les poubelles de serviettes hygiéniques dans les toilettes d’entreprises, éprouvant un dégoût profond pour ce qu’il perçoit comme la souillure ultime, rejetant la femme du côté de l’animalité et de la saleté. L’odeur forte et écoeurante des serviettes usagées déclenche chez lui des vomissements et, comme pour s’en défendre, des accès d’agressivité.
Pour d’autres personnages masculins, il est mystérieux et fascinant, support d’une charge érotique puissante. Le narrateur de Vernis à ongles se voit barrer l’accès du lit de sa maitresse cinq jours par mois. Mais parce qu’il a brisé sa promesse et qu’il n’a pu s’empêcher de l’espionner par le trou de serrure pendant ses règles, elle le quitte pour toujours. Cette réécriture parodique du mythe de Mélusine la femme-serpent montre avec un certain humour les règles comme métaphore du mystère féminin. Surprendre cet écoulement, c’est violer le secret du féminin et l’homme le paiera de son bannissement.
L’auteur reprend les interprétations, et superstitions, plus ou moins fantasmatiques qui existent dans toutes les civilisations sur le sang menstruel et en tire des histoires d’une tonalité fantastique. Dans L’alignement des planètes, les trois jeunes colocataires, sous l’emprise du climat étrange de la maison où elles vivent, voient chaque mois leurs règles arriver au même moment, ce qui crée entre elles une gémellité organique et magique. Dans Magie rouge et Sortilège, deux nouvelles qui encadrent le recueil, le sang est un philtre d’amour. Les héroïnes-sorcières l’intègrent comme ingrédient principal dans l’élaboration de leur sortilège visant à se faire aimer de leur amant. Mais ce sang magique se voit moins qu’il se renifle : son odeur puissante, entêtante et érotique, est ce qui le caractérise. Dans Technique mixte, un collectionneur dévoile le secret de la beauté des oeuvres d’une artiste grâce à son flair. Reniflant comme un sanglier le tracé des dessins, il finit par comprendre que l’encre utilisée par l’artiste est son propre sang menstruel.
Dans la plupart des récits, les menstruations mettent résolument la femme de l’autre côté de l’homme, sur l’inquiétant continent du sacré et du mystère. Les personnages masculins ne savent pas trop quoi faire avec ces « affaires » et, comme pour s’approprier quelque chose qui leur échappe, ils en font une manne financière. Dans La coupe est pleine, on assiste à l’échange cynique d’hommes d’affaires évoquant la mise sur le marché d’une protection hygiénique révolutionnaire. Les règles sont aussi une affaire de gros sous.
De l’humour au fantastique, Pascale Pujol nous offre avec son recueil une réjouissante variation autour d’un thème peu évoqué en littérature. Car si ce thème est aujourd’hui, dans la mouvance des courants féministes, réhabilité et évoqué dans les médias, il l’a rarement été dans la fiction. Ce livre a l’intérêt de faire rentrer dans le répertoire littéraire cet objet secret et mis à l’écart.
Géraldine Doutriaux
Sanguines de Pascale Pujol
Editions Quadrature
96 pages 16 euros
Pascale Dujol
Editions Quadrature
Sanguines de Pascale Pujol est une variation autour du motif écarlate, universel et pourtant tabou, du sang. Tabou parce qu’il ne s’agit pas du sang héroïque ou pathétique de la blessure ou de la maladie, mais de celui sans concession, voire repoussant, des menstruations. Il irrigue tout le recueil et tel un talisman rouge, maléfique ou bénéfique, il irradie au coeur de chaque nouvelle. L’auteur décline et crée des histoires autour de tout ce qu’évoque dans l’imaginaire ce sang métonymie du féminin.
Ainsi il est de manière attendue dans Le passage le symbole de la puberté et du passage à l’âge adulte pour Margaux que la venue des règles va éloigner de sa mère. Plus original, la nouvelle Lady Net montre un héros, dont le métier consiste à jeter les poubelles de serviettes hygiéniques dans les toilettes d’entreprises, éprouvant un dégoût profond pour ce qu’il perçoit comme la souillure ultime, rejetant la femme du côté de l’animalité et de la saleté. L’odeur forte et écoeurante des serviettes usagées déclenche chez lui des vomissements et, comme pour s’en défendre, des accès d’agressivité.
Pour d’autres personnages masculins, il est mystérieux et fascinant, support d’une charge érotique puissante. Le narrateur de Vernis à ongles se voit barrer l’accès du lit de sa maitresse cinq jours par mois. Mais parce qu’il a brisé sa promesse et qu’il n’a pu s’empêcher de l’espionner par le trou de serrure pendant ses règles, elle le quitte pour toujours. Cette réécriture parodique du mythe de Mélusine la femme-serpent montre avec un certain humour les règles comme métaphore du mystère féminin. Surprendre cet écoulement, c’est violer le secret du féminin et l’homme le paiera de son bannissement.
L’auteur reprend les interprétations, et superstitions, plus ou moins fantasmatiques qui existent dans toutes les civilisations sur le sang menstruel et en tire des histoires d’une tonalité fantastique. Dans L’alignement des planètes, les trois jeunes colocataires, sous l’emprise du climat étrange de la maison où elles vivent, voient chaque mois leurs règles arriver au même moment, ce qui crée entre elles une gémellité organique et magique. Dans Magie rouge et Sortilège, deux nouvelles qui encadrent le recueil, le sang est un philtre d’amour. Les héroïnes-sorcières l’intègrent comme ingrédient principal dans l’élaboration de leur sortilège visant à se faire aimer de leur amant. Mais ce sang magique se voit moins qu’il se renifle : son odeur puissante, entêtante et érotique, est ce qui le caractérise. Dans Technique mixte, un collectionneur dévoile le secret de la beauté des oeuvres d’une artiste grâce à son flair. Reniflant comme un sanglier le tracé des dessins, il finit par comprendre que l’encre utilisée par l’artiste est son propre sang menstruel.
Dans la plupart des récits, les menstruations mettent résolument la femme de l’autre côté de l’homme, sur l’inquiétant continent du sacré et du mystère. Les personnages masculins ne savent pas trop quoi faire avec ces « affaires » et, comme pour s’approprier quelque chose qui leur échappe, ils en font une manne financière. Dans La coupe est pleine, on assiste à l’échange cynique d’hommes d’affaires évoquant la mise sur le marché d’une protection hygiénique révolutionnaire. Les règles sont aussi une affaire de gros sous.
De l’humour au fantastique, Pascale Pujol nous offre avec son recueil une réjouissante variation autour d’un thème peu évoqué en littérature. Car si ce thème est aujourd’hui, dans la mouvance des courants féministes, réhabilité et évoqué dans les médias, il l’a rarement été dans la fiction. Ce livre a l’intérêt de faire rentrer dans le répertoire littéraire cet objet secret et mis à l’écart.
Géraldine Doutriaux
Sanguines de Pascale Pujol
Editions Quadrature
96 pages 16 euros
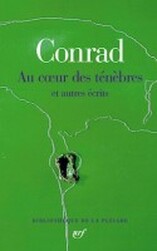
AU COEUR DES TENEBRES ET AUTRES ECRITS
Joseph Conrad
Editions Gallimard
« Je me fais l’effet d’essayer de vous raconter un rêve – vaine entreprise, car aucun récit de rêve ne peut communiquer la sensation du rêve, cette mixture d’absurdité, de surprise et d’ahurissement, dans un frisson de révolte scandalisée, cette impression d’être prisonnier de l’invraisemblable qui est l’essence même du rêve… ».
L’aveu de Marlow concernant l’impuissance – problématique – de la parole, aveu partagé par l’auteur, et, à leur suite, par le lecteur, pourrait traduire un élan déceptif. Or, ce constat n’arrache aucune somptuosité aux lumières et aux ombres cheminant de concert, et en notre compagnie, dès que l’on prend le temps de lire, de vraiment lire Conrad. Ces lumières et ces ombres sont, d’abord (comme c’est le cas toujours), intérieures.
Ainsi que le résume Paul Thibaud, la littérature de Conrad est « une entreprise d’éclaircissement. Il s’agit très souvent d’œuvres brèves qui sont comme des schémas de situations extrêmes où le héros est mis à l’épreuve. La société, contrairement à ce qu’il en est dans les romans classiques, n’est pas en question, le cadre de l’action est un ensemble de conventions et de relations qui constituent un donné, un arrière-fond immobile. La société est en général moins présente que la nature qui est pour le héros comme un reflet ou un défi, un partenaire dans le bonheur ou dans la difficulté. La question posée est toujours : comment être un homme ? » If you can keep your head when all about you / Are losing theirs and blaming it on you… (Kipling). Et le lieu de la mise à l’épreuve – au cours de laquelle il s’agira d’affronter la vie corps à corps, simplement, durement, et avec une allégresse enfouie – est, souvent, un navire…
Conrad, romancier de la mer – dans la lignée de Melville – et de l’aventure (même s’il le fait toujours en jouant avec l’horizon d’attente convoqué) ? Comment aurait-il pu en être autrement ? Sa vie fut une aventure. De son vrai nom Joseph Konrad Korzeniowski, il est né polonais d’Ukraine, en 1857, d’un père qui sera déporté pour participation à l’insurrection antitsariste de 1863. Il a passé, orphelin à 12 ans, sa jeunesse à Cracovie. Puis a émigré en France, à Marseille. Il y a mené une existence – qui se conclura par une tentative de suicide – que d’aucuns pourraient qualifier d’irrégulière. « Gâchant sa vie de façon excentrique », admettra-t-il plus tard. Commençant à naviguer. Et à apprendre l’anglais ! Se mêlant d’un trafic d’armes pour les carlistes d’Espagne…
Comment ne pas voir dans le personnage de Kurtz – qui est le vrai (anti-)héros d’Au cœur des ténèbres–, condensée et transposée, cette période confuse, et germinale ? Le nom de Kurtz, qui signifie « court », paraissant être une contraction de Korzeniowski…
Pétri d’idéalisme, « sauvage » [1], tour à tour décrit comme un fantôme, une apparition, un phénomène, une vapeur, une ombre, ce personnage si ambivalent [2] (dont les contours, à peine esquissés, se perdent aussitôt dans l’immensité du non-dit) doit nous amener, comme le remarque Paul Thibaud, à formuler, à mille lieues d’une glorification possible de l’impérialisme et de ses « bienfaits », une interrogation morale. À comprendre et à critiquer la colonisation « en la prenant par un autre côté que celui dont on a l’habitude, en se demandant ce que vaut une “tentation de faire le bien” occidentale qui n’est pas épuisée, même si elle s’exprime [désormais] à travers des ONG ». Démarche utile, et apparemment voulue par Conrad lui-même qui s’inspira de la façon qu’a eue le philosophe Thomas H. Huxley de rompre avec l’optimisme qui dominait la pensée historique et scientifique à l’époque, même si, constate Jean Deurbergue, Au cœur des ténèbres ne ressemble guère « à un conte didactique, en dépit de sa mise en scène nocturne de transmission initiatique ».
Si Kurtz est de facto le personnage le plus frappant (à hauteur même de son caractère vaporeux) de toute l’œuvre de Conrad, celui vers lequel ira – définitivement – notre cœur est, emprunté au même texte, l’arlequin : « Un éclat magique le poussait à avancer, un éclat magique le préservait de toute atteinte. Il ne demandait sûrement rien au monde sauvage, que la place d’y respirer et de pousser toujours plus loin. Ce qu’il lui fallait, c’était subsister et aller de l’avant avec le plus de risques possible, et un maximum de privations. Si l’esprit d’aventure absolument pur, sans calcul ni souci pratique, avait jamais régné sur un être humain, il régnait sur ce garçon rapiécé ». En conséquence, le pourtant pleinement aventureux Marlow en vient à envier à l’arlequin « la possession de cette flamme modeste et claire »…
Lisez Conrad dans cette édition, prenez à pleines mains, sans crainte de vous brûler, la flamme modeste et claire.
Matthieu Gosztola
[1] Au cœur des ténèbres nous invite « à une profonde méditation sur les rapports de l’humanité et de la sauvagerie », ainsi que le remarque Dominique Rabaté dans Poétiques de la voix.
[2] Subtilement interprété, dans une économie de moyens pleinement expressive, par Marlon Brando dans le film de Coppola.
Lire la partie 1
Au cœur des ténèbres et autres écrits de Joseph Conrad,
La Pléiade, Gallimard
1216 pages 59 €
Publié dans Lacauselitteraire.fr le 27/08/18
Joseph Conrad
Editions Gallimard
« Je me fais l’effet d’essayer de vous raconter un rêve – vaine entreprise, car aucun récit de rêve ne peut communiquer la sensation du rêve, cette mixture d’absurdité, de surprise et d’ahurissement, dans un frisson de révolte scandalisée, cette impression d’être prisonnier de l’invraisemblable qui est l’essence même du rêve… ».
L’aveu de Marlow concernant l’impuissance – problématique – de la parole, aveu partagé par l’auteur, et, à leur suite, par le lecteur, pourrait traduire un élan déceptif. Or, ce constat n’arrache aucune somptuosité aux lumières et aux ombres cheminant de concert, et en notre compagnie, dès que l’on prend le temps de lire, de vraiment lire Conrad. Ces lumières et ces ombres sont, d’abord (comme c’est le cas toujours), intérieures.
Ainsi que le résume Paul Thibaud, la littérature de Conrad est « une entreprise d’éclaircissement. Il s’agit très souvent d’œuvres brèves qui sont comme des schémas de situations extrêmes où le héros est mis à l’épreuve. La société, contrairement à ce qu’il en est dans les romans classiques, n’est pas en question, le cadre de l’action est un ensemble de conventions et de relations qui constituent un donné, un arrière-fond immobile. La société est en général moins présente que la nature qui est pour le héros comme un reflet ou un défi, un partenaire dans le bonheur ou dans la difficulté. La question posée est toujours : comment être un homme ? » If you can keep your head when all about you / Are losing theirs and blaming it on you… (Kipling). Et le lieu de la mise à l’épreuve – au cours de laquelle il s’agira d’affronter la vie corps à corps, simplement, durement, et avec une allégresse enfouie – est, souvent, un navire…
Conrad, romancier de la mer – dans la lignée de Melville – et de l’aventure (même s’il le fait toujours en jouant avec l’horizon d’attente convoqué) ? Comment aurait-il pu en être autrement ? Sa vie fut une aventure. De son vrai nom Joseph Konrad Korzeniowski, il est né polonais d’Ukraine, en 1857, d’un père qui sera déporté pour participation à l’insurrection antitsariste de 1863. Il a passé, orphelin à 12 ans, sa jeunesse à Cracovie. Puis a émigré en France, à Marseille. Il y a mené une existence – qui se conclura par une tentative de suicide – que d’aucuns pourraient qualifier d’irrégulière. « Gâchant sa vie de façon excentrique », admettra-t-il plus tard. Commençant à naviguer. Et à apprendre l’anglais ! Se mêlant d’un trafic d’armes pour les carlistes d’Espagne…
Comment ne pas voir dans le personnage de Kurtz – qui est le vrai (anti-)héros d’Au cœur des ténèbres–, condensée et transposée, cette période confuse, et germinale ? Le nom de Kurtz, qui signifie « court », paraissant être une contraction de Korzeniowski…
Pétri d’idéalisme, « sauvage » [1], tour à tour décrit comme un fantôme, une apparition, un phénomène, une vapeur, une ombre, ce personnage si ambivalent [2] (dont les contours, à peine esquissés, se perdent aussitôt dans l’immensité du non-dit) doit nous amener, comme le remarque Paul Thibaud, à formuler, à mille lieues d’une glorification possible de l’impérialisme et de ses « bienfaits », une interrogation morale. À comprendre et à critiquer la colonisation « en la prenant par un autre côté que celui dont on a l’habitude, en se demandant ce que vaut une “tentation de faire le bien” occidentale qui n’est pas épuisée, même si elle s’exprime [désormais] à travers des ONG ». Démarche utile, et apparemment voulue par Conrad lui-même qui s’inspira de la façon qu’a eue le philosophe Thomas H. Huxley de rompre avec l’optimisme qui dominait la pensée historique et scientifique à l’époque, même si, constate Jean Deurbergue, Au cœur des ténèbres ne ressemble guère « à un conte didactique, en dépit de sa mise en scène nocturne de transmission initiatique ».
Si Kurtz est de facto le personnage le plus frappant (à hauteur même de son caractère vaporeux) de toute l’œuvre de Conrad, celui vers lequel ira – définitivement – notre cœur est, emprunté au même texte, l’arlequin : « Un éclat magique le poussait à avancer, un éclat magique le préservait de toute atteinte. Il ne demandait sûrement rien au monde sauvage, que la place d’y respirer et de pousser toujours plus loin. Ce qu’il lui fallait, c’était subsister et aller de l’avant avec le plus de risques possible, et un maximum de privations. Si l’esprit d’aventure absolument pur, sans calcul ni souci pratique, avait jamais régné sur un être humain, il régnait sur ce garçon rapiécé ». En conséquence, le pourtant pleinement aventureux Marlow en vient à envier à l’arlequin « la possession de cette flamme modeste et claire »…
Lisez Conrad dans cette édition, prenez à pleines mains, sans crainte de vous brûler, la flamme modeste et claire.
Matthieu Gosztola
[1] Au cœur des ténèbres nous invite « à une profonde méditation sur les rapports de l’humanité et de la sauvagerie », ainsi que le remarque Dominique Rabaté dans Poétiques de la voix.
[2] Subtilement interprété, dans une économie de moyens pleinement expressive, par Marlon Brando dans le film de Coppola.
Lire la partie 1
Au cœur des ténèbres et autres écrits de Joseph Conrad,
La Pléiade, Gallimard
1216 pages 59 €
Publié dans Lacauselitteraire.fr le 27/08/18
ENTRETIEN AVEC PASCALE PUJOL
autour de son recueil
Sanguines

Le recueil
Dans « Le sari rouge », l’une des nouvelles de mon premier recueil, Fragments d’un texto amoureux, le thème du sang féminin était apparu un peu par hasard. Rapidement, j’ai eu envie d’aller d’explorer et de me réapproprier les légendes et croyances autour de ce sujet tabou et j’ai écrit « Magie rouge » et « Sortilège », les textes d’ouverture et de fin de Sanguines. Le titre de Sanguines s’est d’ailleurs imposé très tôt dans mon esprit comme celui d’un vrai projet.
Je n’ai pas construit de « pich » du recueil, avec par exemple une liste exhaustive des situations à traiter, mais j’ai attendu que les histoires viennent à moi. J’avais plutôt des ambiances à l’esprit, des émotions, et j’ai pris le parti d’utiliser plusieurs registres d’écriture (noir, comédie, intimiste, ésotérique…) et différents types de narration, en prenant des points de vue féminins et masculins. Cela s’est fait de manière très naturelle. Sur les douze textes, on trouve d’ailleurs trois narrateurs et seulement deux narratrices, et dans quatre nouvelles l’intrigue tourne uniquement autour de personnages et de propos masculins. En effet, mon idée n’était pas d’écrire sur les femmes ni pour les femmes mais sur un sujet qui concerne toute l’humanité à un moment ou un autre. Les retours positifs de lecteurs masculins m’ont d’ailleurs confortée dans le sentiment que j’y étais parvenue, pour eux en tout cas.
La difficulté a probablement résidé dans le parti pris d’opter pour un thème, une vraie toile de fond, tout en faisant la place à une histoire forte qui s’inscrit dans ce thème en le dépassant : l’échec et le déclassement social pour « Lady-net », le fait d’affronter la maladie et la vieillesse pour « La Boîte à secrets », le cynisme du monde de l’entreprise dans « La coupe est pleine », la liberté dans « Le samovar », la quête amoureuse qui tourne à la folie dans « Magie rouge », les derniers souvenirs que l’on emporte au moment de mourir pour « Dernier Round »… Le sang féminin est le medium de ces histoires, mais pas leur but, enfin il me semble. C’est pour cela que l’écriture du recueil a pris du temps.
Certaines nouvelles m’ont donné du fil à retordre, comme « L’alignement des planètes » : c’est la dernière écrite alors que l’idée était présente depuis le début. Je voulais illustrer cette croyance sur la synchronisation des cycles menstruels quand des femmes vivent ensemble, mais il a fallu du temps pour trouver les bons ressorts narratifs.
Mes nouvelles préférées
J’ai un petit faible pour « Technique mixte » qui est le prétexte à moquer le monde de l’art et où j’ai eu grand plaisir à croquer les personnages, notamment l’artiste peintre qui est évoquée, dont j’ai fait une figure loufoque et féministe, très libre. J’aime aussi beaucoup « Le samovar » parce qu’il joue sur la suggestion, qui est pour moi un art délectable en écriture. Et pour finir « La boîte à secrets », qui tourne autour du thème de la relation mère-fille, de la transmission et du temps qui passe. J’ai tourné longtemps autour avant d’aboutir au résultat que j’attendais, sur un registre émotionnel très intime. Il s’inscrit aussi à sa manière dans la suggestion, et je pense qu’il transcende vraiment le propos initial pour nous parler d’autre chose.
L’écriture du recueil
L’écriture s’est étalée sur deux années entières avec plusieurs périodes creuses qui pouvaient durer plusieurs mois et d’autres plus prolifiques. En général, le premier jet d’une nouvelle ne me prend guère plus de quelques jours, d’autant qu’elles sont courtes. L’écriture d’un roman, en revanche, s’inscrit dans une autre perspective, celle de la continuité de l’intrigue dans la durée, et demande beaucoup plus de souffle, plus de patience aussi. Avec une nouvelle, même si je ne sais pas où je vais, je sais que je vais rapidement le découvrir !
L’art de la nouvelle
Je ne théorise pas sur mes lectures car je suis un lectrice enthousiaste et passionnée plus qu’analytique. Je suis toujours amusée des discussions que l’on peut entendre ici ou là sur l’art de la nouvelle à l’anglo-saxonne, une sorte de pose où seul Carver trouverait grâce…
Je dirais que la tension est un élément nécessaire, que la nouvelle soit longue ou courte d’ailleurs. Une certaine concision aussi, mais cela ne signifie pas pour moi la sécheresse de la langue pour autant ! Je n’aime pas trop l’expression d’écriture « à l’os » qu’emploient certains auteurs que je trouve caricaturale (parfois, l’os sans viande est quand même très, très triste…), même si, comme tout le monde, j’essaie de traquer le superflu. Concernant les fameuse chutes, je n’ai pas d’avis tranché : je les apprécie quand elles sont menées avec subtilité, notamment quand il y a une « double chute » (ce que j’essaie de pratiquer moi-même), mais je n’aime pas les pirouettes convenues ou les chutes que l’on voit venir trop vite et surtout, de manière appuyée. Ce qui m’impressionne souvent chez les auteurs anglo-saxons, c’est leur manière abrupte d’entrer dans l’histoire et d’en sortir, comme au milieu d’une phrase, de laisser leurs personnages poursuivre leur vie et les lecteurs imaginer la suite.
Un bon recueil, c’est un recueil de qualité égale d’un bout à l’autre, peu importe qu’il soit thématique ou non. Je n’aime pas les recueils où la majorité des textes sont médiocres à côté d’une ou deux bonnes nouvelles.
Mes lectures
Je suis très éclectique dans mes lectures : je n’ai pas à proprement d’auteur de chevet, hormis peut-être Joyce Carol Oates (dont j’aime autant les nouvelles que les romans) pour sa capacité à creuser l’âme humaine et son immense talent de narration. Récemment, j’ai découvert et apprécié les nouvelles de Sylvain Tesson, que je trouve pleines de force. J’ai également découvert il y a peu Jean-Pierre Cannet, lauréat du Prix Boccace en 2014 avec Le grand labeur. J’ai été séduite par une vraie liberté de ton et l’univers très poétique de ces textes assez courts où la tendresse et le drame cohabitent avec légèreté.
Pour autant, je ne sais pas précisément ce que je puise dans mes lectures : tout est susceptible de nourrir mon travail d’auteure, qui est également très éclectique.
Un conseil de lecture
Je lis beaucoup et j’ai la fâcheuse tendance d’oublier ce que j’ai lu. Mais je pense à une nouvelle de Kundera, « Le jeu de l’auto-stop », découverte il y a une trentaine d’années et jamais relue depuis, mais qui m’a beaucoup marquée. Un jeune couple part en vacances ; après un arrêt à une station-service, la jeune femme ne remonte pas directement dans la voiture mais fait du stop, et son compagnon rentre dans le jeu et la prend en stop comme s’il ne la connaissait pas. Tout bascule en jeu cruel où les protagonistes ne peuvent plus revenir en arrière. L’enchaînement dramatique m’avait paru implacable.
L’éditeur
Quadrature n’édite que des nouvelles depuis sa création en 2005 et il me semble que la maison a réussi à se construire une identité propre, avec une petite quarantaine d’auteurs francophones. La ligne éditoriale est assez diversifiée, avec des recueils thématiques ou non, et également des micro-fictions. Quand un manuscrit est sélectionné, deux personnes de l’équipe en deviennent les parrains ou marraines et accompagnent le travail éditorial jusqu’à la publication. Il y a un vrai esprit de famille qui culmine chaque année à la Foire de Bruxelles.
Dans « Le sari rouge », l’une des nouvelles de mon premier recueil, Fragments d’un texto amoureux, le thème du sang féminin était apparu un peu par hasard. Rapidement, j’ai eu envie d’aller d’explorer et de me réapproprier les légendes et croyances autour de ce sujet tabou et j’ai écrit « Magie rouge » et « Sortilège », les textes d’ouverture et de fin de Sanguines. Le titre de Sanguines s’est d’ailleurs imposé très tôt dans mon esprit comme celui d’un vrai projet.
Je n’ai pas construit de « pich » du recueil, avec par exemple une liste exhaustive des situations à traiter, mais j’ai attendu que les histoires viennent à moi. J’avais plutôt des ambiances à l’esprit, des émotions, et j’ai pris le parti d’utiliser plusieurs registres d’écriture (noir, comédie, intimiste, ésotérique…) et différents types de narration, en prenant des points de vue féminins et masculins. Cela s’est fait de manière très naturelle. Sur les douze textes, on trouve d’ailleurs trois narrateurs et seulement deux narratrices, et dans quatre nouvelles l’intrigue tourne uniquement autour de personnages et de propos masculins. En effet, mon idée n’était pas d’écrire sur les femmes ni pour les femmes mais sur un sujet qui concerne toute l’humanité à un moment ou un autre. Les retours positifs de lecteurs masculins m’ont d’ailleurs confortée dans le sentiment que j’y étais parvenue, pour eux en tout cas.
La difficulté a probablement résidé dans le parti pris d’opter pour un thème, une vraie toile de fond, tout en faisant la place à une histoire forte qui s’inscrit dans ce thème en le dépassant : l’échec et le déclassement social pour « Lady-net », le fait d’affronter la maladie et la vieillesse pour « La Boîte à secrets », le cynisme du monde de l’entreprise dans « La coupe est pleine », la liberté dans « Le samovar », la quête amoureuse qui tourne à la folie dans « Magie rouge », les derniers souvenirs que l’on emporte au moment de mourir pour « Dernier Round »… Le sang féminin est le medium de ces histoires, mais pas leur but, enfin il me semble. C’est pour cela que l’écriture du recueil a pris du temps.
Certaines nouvelles m’ont donné du fil à retordre, comme « L’alignement des planètes » : c’est la dernière écrite alors que l’idée était présente depuis le début. Je voulais illustrer cette croyance sur la synchronisation des cycles menstruels quand des femmes vivent ensemble, mais il a fallu du temps pour trouver les bons ressorts narratifs.
Mes nouvelles préférées
J’ai un petit faible pour « Technique mixte » qui est le prétexte à moquer le monde de l’art et où j’ai eu grand plaisir à croquer les personnages, notamment l’artiste peintre qui est évoquée, dont j’ai fait une figure loufoque et féministe, très libre. J’aime aussi beaucoup « Le samovar » parce qu’il joue sur la suggestion, qui est pour moi un art délectable en écriture. Et pour finir « La boîte à secrets », qui tourne autour du thème de la relation mère-fille, de la transmission et du temps qui passe. J’ai tourné longtemps autour avant d’aboutir au résultat que j’attendais, sur un registre émotionnel très intime. Il s’inscrit aussi à sa manière dans la suggestion, et je pense qu’il transcende vraiment le propos initial pour nous parler d’autre chose.
L’écriture du recueil
L’écriture s’est étalée sur deux années entières avec plusieurs périodes creuses qui pouvaient durer plusieurs mois et d’autres plus prolifiques. En général, le premier jet d’une nouvelle ne me prend guère plus de quelques jours, d’autant qu’elles sont courtes. L’écriture d’un roman, en revanche, s’inscrit dans une autre perspective, celle de la continuité de l’intrigue dans la durée, et demande beaucoup plus de souffle, plus de patience aussi. Avec une nouvelle, même si je ne sais pas où je vais, je sais que je vais rapidement le découvrir !
L’art de la nouvelle
Je ne théorise pas sur mes lectures car je suis un lectrice enthousiaste et passionnée plus qu’analytique. Je suis toujours amusée des discussions que l’on peut entendre ici ou là sur l’art de la nouvelle à l’anglo-saxonne, une sorte de pose où seul Carver trouverait grâce…
Je dirais que la tension est un élément nécessaire, que la nouvelle soit longue ou courte d’ailleurs. Une certaine concision aussi, mais cela ne signifie pas pour moi la sécheresse de la langue pour autant ! Je n’aime pas trop l’expression d’écriture « à l’os » qu’emploient certains auteurs que je trouve caricaturale (parfois, l’os sans viande est quand même très, très triste…), même si, comme tout le monde, j’essaie de traquer le superflu. Concernant les fameuse chutes, je n’ai pas d’avis tranché : je les apprécie quand elles sont menées avec subtilité, notamment quand il y a une « double chute » (ce que j’essaie de pratiquer moi-même), mais je n’aime pas les pirouettes convenues ou les chutes que l’on voit venir trop vite et surtout, de manière appuyée. Ce qui m’impressionne souvent chez les auteurs anglo-saxons, c’est leur manière abrupte d’entrer dans l’histoire et d’en sortir, comme au milieu d’une phrase, de laisser leurs personnages poursuivre leur vie et les lecteurs imaginer la suite.
Un bon recueil, c’est un recueil de qualité égale d’un bout à l’autre, peu importe qu’il soit thématique ou non. Je n’aime pas les recueils où la majorité des textes sont médiocres à côté d’une ou deux bonnes nouvelles.
Mes lectures
Je suis très éclectique dans mes lectures : je n’ai pas à proprement d’auteur de chevet, hormis peut-être Joyce Carol Oates (dont j’aime autant les nouvelles que les romans) pour sa capacité à creuser l’âme humaine et son immense talent de narration. Récemment, j’ai découvert et apprécié les nouvelles de Sylvain Tesson, que je trouve pleines de force. J’ai également découvert il y a peu Jean-Pierre Cannet, lauréat du Prix Boccace en 2014 avec Le grand labeur. J’ai été séduite par une vraie liberté de ton et l’univers très poétique de ces textes assez courts où la tendresse et le drame cohabitent avec légèreté.
Pour autant, je ne sais pas précisément ce que je puise dans mes lectures : tout est susceptible de nourrir mon travail d’auteure, qui est également très éclectique.
Un conseil de lecture
Je lis beaucoup et j’ai la fâcheuse tendance d’oublier ce que j’ai lu. Mais je pense à une nouvelle de Kundera, « Le jeu de l’auto-stop », découverte il y a une trentaine d’années et jamais relue depuis, mais qui m’a beaucoup marquée. Un jeune couple part en vacances ; après un arrêt à une station-service, la jeune femme ne remonte pas directement dans la voiture mais fait du stop, et son compagnon rentre dans le jeu et la prend en stop comme s’il ne la connaissait pas. Tout bascule en jeu cruel où les protagonistes ne peuvent plus revenir en arrière. L’enchaînement dramatique m’avait paru implacable.
L’éditeur
Quadrature n’édite que des nouvelles depuis sa création en 2005 et il me semble que la maison a réussi à se construire une identité propre, avec une petite quarantaine d’auteurs francophones. La ligne éditoriale est assez diversifiée, avec des recueils thématiques ou non, et également des micro-fictions. Quand un manuscrit est sélectionné, deux personnes de l’équipe en deviennent les parrains ou marraines et accompagnent le travail éditorial jusqu’à la publication. Il y a un vrai esprit de famille qui culmine chaque année à la Foire de Bruxelles.
Sanguines de Pascale Pujol, Editions Quadrature, 96 pages, 16 euros.
ENTRETIEN AVEC FRANCOISE COHEN
autour de
L’empreinte volée

Le recueil
J’ai écrit ce recueil en suivant une thématique que j’avais choisie au préalable. C’est un travail que j’ai effectué dans une période relativement courte, par rapport à mon précédent recueil qui, lui, s’était composé progressivement au cours de nombreuses années. Les thèmes de l’identité, de la mémoire, de la nostalgie du temps passé sont récurrents dans ces dix nouvelles. Mais d’autres thèmes sont venus se greffer sur cette trame, et ce sont les lecteurs qui me font remarquer, par exemple, que mes personnages s’adonnent souvent à la promenade, à Paris ou à Buenos Aires…
La nouvelle la plus représentative
Je suis attachée à Violaine et les songes, cependant je ne pense pas que ce soit la plus réussie… Elle traite du thème de « l’effacement » qui m’est cher. Un effacement psychologique, mais aussi physique. Violaine, Française vivant à Buenos Aires, constate en regardant son image dans le miroir que ses traits s’estompent chaque jour davantage. Je n’en dirai pas plus. J’ai utilisé entre autres une expérience vécue dans un « atelier des songes » pour composer cette nouvelle. C’est un texte que l’on peut classer parmi les nouvelles fantastiques. Il y en a un autre de ce genre dans le recueil (Rêves postiches). En réalité, les neuf autres nouvelles du recueil sont plus ancrées dans la réalité, tout en étant toujours à la lisière de mondes oniriques.
Pour entendre un extrait de la nouvelle lue par l'auteur cliquez ici.
L’écriture
J’ai mis à peu près un an et demi, en écrivant avec une certaine régularité, à mon rythme, qui est plutôt lent. L’une des plus difficiles a peut-être été pour moi : Consuelo et les clefs du royaume. C’est un thème, celui des « bonnes espagnoles » d’autrefois, que je voulais traiter depuis longtemps, sans savoir comment l’aborder. Je craignais de m’appesantir, de ne pas être capable de me mettre dans la peau de mon personnage…
Une bonne nouvelle
Une bonne nouvelle pour moi est fluide, coule de source, alors qu’elle est composée d’éléments hétérogènes qu’il a fallu synthétiser et unifier. Elle peut vous emporter autant par l’action que par les sentiments. L’émotion est pour moi importante. L’espace étant limité, il s’agit avant tout de suggérer, mais aussi de frapper les esprits. Une bonne nouvelle est aussi prenante qu’un bon roman, mais elle fait peut-être plus rêver … Le défaut est de traiter un sujet trop étriqué, qui manquerait d’intérêt. Ou bien au contraire d’avoir des ambitions démesurées pour ce format restreint.
Mes nouvellistes préférés
Julien Green, maître du fantastique et de la sensibilité. Ray Bradbury qui m’enchante toujours autant par la profondeur de ses histoires futuristes. Clarice Lispector, un phénomène, c’est la Virginia Woolf brésilienne, avec une plus grande modernité et un côté mystérieux qui m’attire.
Une recommandation de lecture
J’ai adoré récemment la lecture d’une nouvelle intitulée Femme nue jouant Chopin de Louise Erdrich, auteure américaine actuelle. C’est aussi le titre du recueil. L’auteure excelle à créer des images extrêmement fortes et originales. Les situations sont inattendues, le point de vue toujours très personnel, mais l’on arrive à s’identifier à ce personnage de femme qui monte au septième ciel lorsqu’elle joue du piano, nue.
L’éditeur
Tituli est une maison d’édition récente (4 ans d’existence) et généraliste. La nouvelle ne représente qu’une petite partie de sa production qui comporte des récits, des romans, du théâtre, de la poésie… Comme pour les autres genres, l’éditeur donne la priorité à l’écriture. On trouve dans leur catalogue aussi bien des auteurs confirmés, avec une longue trajectoire derrière eux, que de nouveaux auteurs. Les publications se font en numérique et en papier. Pour promouvoir la rencontre réelle entre auteurs et lecteurs, des lectures sont organisées pour chaque lancement dans un très bel espace, la librairie Tituli, à Montparnasse.

Françoise Cohen
L'empreinte volée de Françoise Cohen, Editions Tituli, 105 pages, 14 euros.
Pour accéder au site de l'éditeur cliquez ici.
ENTRETIEN AVEC THIERRY COVOLO
autour de
La plus jeune des frères Crimson
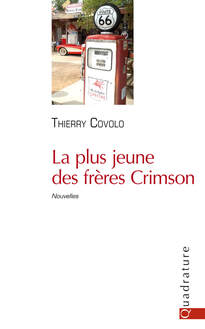
Le recueil
Le recueil La plus jeune des frères Crimson réunit dix nouvelles écrites entre 2013 et 2018. Si ces nouvelles ne partagent pas une même thématique, elles se rejoignent par plusieurs caractéristiques : un arrière-plan nord-américain pour la plupart d’entre-elles, des personnages féminins forts qui, chacun à sa façon, composent face à la violence des hommes, un jeu de faux-semblants où les gens sont rarement qui l’on pourrait croire. Huit d’entre elles ont été publiées en revue avant de rejoindre ce recueil, dont « Les bottes de Bob » dans le numéro 39 de Rue Saint-Ambroise.
La nouvelle la plus représentative
Sans aucun doute « Dernière illusion ». C’est autour de cette nouvelle qu’a été construit le recueil, autant le choix des autres textes que leur ordonnancement.
« Dernière illusion » est une nouvelle généralement très appréciée des lecteurs. Elle a d’ailleurs été récompensée en 2015 du prix de la revue L’Encrier Renversé et de la ville de Castres. Mais surtout, j’ai développé un fort attachement pour Tom et Carrie, ses deux principaux protagonistes. J’ai en effet passé pas mal de temps avec eux. Plusieurs mois se sont écoulés entre la première image de l’histoire (une fille dans un bar paumé, en train de manger des cookies que prépare pour elle, chaque jour, le type qui tient le bar, le tout dans une ambiance à la Hopper) et le début de son écriture, à me demander pourquoi Carrie s’arrêtait chaque jour dans ce bar, quelle histoire la liait à Tom, jusqu’où Tom irait pour que chaque jour elle s’arrête dans ce bar et y trouve les gâteaux qu’elle affectionne.
A la fin, ça donne une histoire qui se passe dans un bar sur une route que prennent les paumés qui vont à Vegas, un endroit où croire que les rêves peuvent changer une vie, où l’on se dit qu’en flambant tout on arrivera peut-être à rafler la mise.
L’écriture du recueil
Quatre années se sont écoulées entre la nouvelle la plus ancienne et la plus récente. Mes temps d’écriture sont essentiellement concentrés sur les week-ends et les vacances, activité professionnelle prenante oblige. Entre premiers jets « créatifs » et améliorations « techniques », il est difficile à évaluer. D’autant que je retravaille beaucoup mes textes. C’est potentiellement sans fin.
Qu’est-ce qu’une bonne nouvelle ?
De mon point de vue, la définition d’une bonne nouvelle est la mise en place d’une tension et sa résolution. Tout dans le texte doit servir cette progression. La psychologie des personnages et leurs interactions, le point de vue, les indices – vrais ou faux –, la construction, la langue… Individuellement et dans l’ensemble, tout doit être cohérent et œuvrer à ce que le lecteur soit plongé dans l’action et ressente des émotions. Je pense qu’une vraie bonne nouvelle est une nouvelle où une connexion directe se fait entre l’histoire et le lecteur, où l’on oublie même qu’il y a un auteur. L’auteur doit devenir invisible. Rien ne m’agace plus que les auteurs qui écrivent pour que l’on se dise qu’ils font de très belles phrases ou qu’ils sont des personnes intéressantes.
Mes nouvellistes préférés
Raymond Carver bien évidemment, mais aussi Claire Keegan, Ron Rash, Yoko Ogawa, Flannery O’Connor, Ernest Hemingway… La liste est très longue.
Dans leur ensemble, ces auteurs m’ont fait comprendre qu’il n’est pas nécessaire qu’une histoire soit spectaculaire pour marquer le lecteur. J’ai aussi appris d’eux que tout ce qui ne sert pas doit être supprimé (des pans d’histoires, des phrases, des mots, des développements, des personnages…). Enfin, ils m’ont montré que plus que l’imagination un travail rigoureux est essentiel pour faire fonctionner une histoire.
Une recommandation
« Le camion de poussins » de Yoko Ogawa. Une des nouvelles du recueil La mer qui raconte la façon dont un improbable lien va se nouer entre un vieil homme, portier depuis une quarantaine d’années dans un hôtel, et la petite fille de sa logeuse, âgée de six ans et muette depuis la mort de sa mère.
C’est une nouvelle remarquable en cela que toutes ses constituantes (la construction, la psychologie des personnages, le point de vue, la langue) s’unissent pour transmettre une émotion au lecteur, et y parviennent parfaitement. Un véritable cas d’école.
L’éditeur
La plus jeune des frères Crimson est publié chez Quadrature, une maison d'édition belge qui se consacre totalement à la publication de recueils de nouvelles francophones. Cette maison a été créée en 2005 et publie en moyenne 5 recueils par année, toujours à compte d'éditeur.
La plus jeune des frères Crimson de Thierry Covolo, Editions Quadrature, 126 p., 16€
Recueil disponible en librairie depuis le 10 avril 2018
Commandes chez l'éditeur : [email protected] (frais de port offerts)
Pour en savoir plus sur l'auteur
Le recueil La plus jeune des frères Crimson réunit dix nouvelles écrites entre 2013 et 2018. Si ces nouvelles ne partagent pas une même thématique, elles se rejoignent par plusieurs caractéristiques : un arrière-plan nord-américain pour la plupart d’entre-elles, des personnages féminins forts qui, chacun à sa façon, composent face à la violence des hommes, un jeu de faux-semblants où les gens sont rarement qui l’on pourrait croire. Huit d’entre elles ont été publiées en revue avant de rejoindre ce recueil, dont « Les bottes de Bob » dans le numéro 39 de Rue Saint-Ambroise.
La nouvelle la plus représentative
Sans aucun doute « Dernière illusion ». C’est autour de cette nouvelle qu’a été construit le recueil, autant le choix des autres textes que leur ordonnancement.
« Dernière illusion » est une nouvelle généralement très appréciée des lecteurs. Elle a d’ailleurs été récompensée en 2015 du prix de la revue L’Encrier Renversé et de la ville de Castres. Mais surtout, j’ai développé un fort attachement pour Tom et Carrie, ses deux principaux protagonistes. J’ai en effet passé pas mal de temps avec eux. Plusieurs mois se sont écoulés entre la première image de l’histoire (une fille dans un bar paumé, en train de manger des cookies que prépare pour elle, chaque jour, le type qui tient le bar, le tout dans une ambiance à la Hopper) et le début de son écriture, à me demander pourquoi Carrie s’arrêtait chaque jour dans ce bar, quelle histoire la liait à Tom, jusqu’où Tom irait pour que chaque jour elle s’arrête dans ce bar et y trouve les gâteaux qu’elle affectionne.
A la fin, ça donne une histoire qui se passe dans un bar sur une route que prennent les paumés qui vont à Vegas, un endroit où croire que les rêves peuvent changer une vie, où l’on se dit qu’en flambant tout on arrivera peut-être à rafler la mise.
L’écriture du recueil
Quatre années se sont écoulées entre la nouvelle la plus ancienne et la plus récente. Mes temps d’écriture sont essentiellement concentrés sur les week-ends et les vacances, activité professionnelle prenante oblige. Entre premiers jets « créatifs » et améliorations « techniques », il est difficile à évaluer. D’autant que je retravaille beaucoup mes textes. C’est potentiellement sans fin.
Qu’est-ce qu’une bonne nouvelle ?
De mon point de vue, la définition d’une bonne nouvelle est la mise en place d’une tension et sa résolution. Tout dans le texte doit servir cette progression. La psychologie des personnages et leurs interactions, le point de vue, les indices – vrais ou faux –, la construction, la langue… Individuellement et dans l’ensemble, tout doit être cohérent et œuvrer à ce que le lecteur soit plongé dans l’action et ressente des émotions. Je pense qu’une vraie bonne nouvelle est une nouvelle où une connexion directe se fait entre l’histoire et le lecteur, où l’on oublie même qu’il y a un auteur. L’auteur doit devenir invisible. Rien ne m’agace plus que les auteurs qui écrivent pour que l’on se dise qu’ils font de très belles phrases ou qu’ils sont des personnes intéressantes.
Mes nouvellistes préférés
Raymond Carver bien évidemment, mais aussi Claire Keegan, Ron Rash, Yoko Ogawa, Flannery O’Connor, Ernest Hemingway… La liste est très longue.
Dans leur ensemble, ces auteurs m’ont fait comprendre qu’il n’est pas nécessaire qu’une histoire soit spectaculaire pour marquer le lecteur. J’ai aussi appris d’eux que tout ce qui ne sert pas doit être supprimé (des pans d’histoires, des phrases, des mots, des développements, des personnages…). Enfin, ils m’ont montré que plus que l’imagination un travail rigoureux est essentiel pour faire fonctionner une histoire.
Une recommandation
« Le camion de poussins » de Yoko Ogawa. Une des nouvelles du recueil La mer qui raconte la façon dont un improbable lien va se nouer entre un vieil homme, portier depuis une quarantaine d’années dans un hôtel, et la petite fille de sa logeuse, âgée de six ans et muette depuis la mort de sa mère.
C’est une nouvelle remarquable en cela que toutes ses constituantes (la construction, la psychologie des personnages, le point de vue, la langue) s’unissent pour transmettre une émotion au lecteur, et y parviennent parfaitement. Un véritable cas d’école.
L’éditeur
La plus jeune des frères Crimson est publié chez Quadrature, une maison d'édition belge qui se consacre totalement à la publication de recueils de nouvelles francophones. Cette maison a été créée en 2005 et publie en moyenne 5 recueils par année, toujours à compte d'éditeur.
La plus jeune des frères Crimson de Thierry Covolo, Editions Quadrature, 126 p., 16€
Recueil disponible en librairie depuis le 10 avril 2018
Commandes chez l'éditeur : [email protected] (frais de port offerts)
Pour en savoir plus sur l'auteur
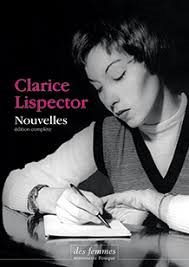
NOUVELLES DE CLARICE LISPECTOR
Un monument ! C’est un monument que les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous présentent, 85 nouvelles publiées entre 1939 et sa mort, en 1977, en reprenant la chronologie, ce qui permet de suivre l’évolution de la créatrice brésilienne tout en faisant ressortir la grande continuité de son inspiration. On connaît encore trop mal cette immense écrivaine, certes reconnue par un important noyau d’amateurs, mais qui mérite la reconnaissance d’un plus vaste public.
La femme est au centre de ces récits, peu d’auteurs ont décrit avec autant de finesse la complexité des personnalités humaines, pas seulement féminines. C’est toute une société qui apparaît, une vision acérée mais jamais vraiment cruelle, l’être humain n’est ni plus ni moins qu’un être humain, les femmes de ce concert jouant leur partition, parfois avec davantage de difficulté que les hommes, parfois se lançant dans un solo qui sera d’autant plus remarqué.
Les désirs, le désir, ce vide encore à combler apparaît souvent, habituel dans une société encore corsetée par les traditions et la religion environnante. Et souvent l’assouvissement a pour résultat d’anéantir le désir. Mieux que de raconter, Clarice Lispector fait naître des sensations.
Corolaire de la notion de désir, la liberté : une jeune femme née, comme l’auteure dans les années 20 du XXème siècle (les « années folles » en France), peut-elle vivre comme ses aïeules, ne pas pressentir que la condition féminine est en train d’évoluer. Beaucoup des héroïnes de ces nouvelles sentent la nécessité de faire comprendre à leurs seigneurs et maîtres que cette époque est terminée. Elles le font avec élégance, sans tapage majeur, mais avec une efficacité redoutable et réjouissante.
Clarice Lispector excelle à faire entrer le lecteur dans des états à la limite entre la réalité et l’impalpable, dus à un égarement passager, parfois à l’alcool et nous fait ressentir ce moment où l’esprit, tout en étant encore en partie conscient de ce qui l’entoure, s’évade vers des terrains flous.
On peut, sans jouer les cuistres, parler de la magie des mots. Clarice Lispector sait les enchaîner en faisant naître le trouble de la beauté ou des aspérités. De la poésie ? Plus exactement une façon de suggérer en trouvant précisément le mot qui fallait, qui parlait au lecteur du temps où elle écrivait comme au lecteur actuel.
Elle sait aussi pratiquer l’humour et par le rire évoquer rien moins que la valeur d’une vie humaine. Elle est aussi à l’aise dans l’évocation subtile des souffrances des femmes et de leurs modestes luttes que dans la description farcesque et sinistre à la fois d’une fête familiale.
On connaît trop peu encore l’œuvre de la romancière brésilienne. Il faut se précipiter sur cette nouvelle parution pour enfin combler cette lacune : Clarice Lispector est un des auteurs les plus importants du XXème siècle, cela ne fait plus aucun doute quand on referme ces Nouvelles.
Nouvelles. Édition complète, de Clarice Lispector, édition établie pas Benjamin Moser, traduit du portugais (Brésil) par Jacques et Teresa Thiériot, Claudia Poncioni, Didier Lamaison, Sylvie Durastanti, Claude Farny, Geneviève Leibrich et Nicole Biros, éd. des femmes-
Christian Roinat
Clarice Lispector : Nouvelles, édition complète.
Editions des femmes-Antoinette Fouque, 482 p., 23 €
Un monument ! C’est un monument que les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous présentent, 85 nouvelles publiées entre 1939 et sa mort, en 1977, en reprenant la chronologie, ce qui permet de suivre l’évolution de la créatrice brésilienne tout en faisant ressortir la grande continuité de son inspiration. On connaît encore trop mal cette immense écrivaine, certes reconnue par un important noyau d’amateurs, mais qui mérite la reconnaissance d’un plus vaste public.
La femme est au centre de ces récits, peu d’auteurs ont décrit avec autant de finesse la complexité des personnalités humaines, pas seulement féminines. C’est toute une société qui apparaît, une vision acérée mais jamais vraiment cruelle, l’être humain n’est ni plus ni moins qu’un être humain, les femmes de ce concert jouant leur partition, parfois avec davantage de difficulté que les hommes, parfois se lançant dans un solo qui sera d’autant plus remarqué.
Les désirs, le désir, ce vide encore à combler apparaît souvent, habituel dans une société encore corsetée par les traditions et la religion environnante. Et souvent l’assouvissement a pour résultat d’anéantir le désir. Mieux que de raconter, Clarice Lispector fait naître des sensations.
Corolaire de la notion de désir, la liberté : une jeune femme née, comme l’auteure dans les années 20 du XXème siècle (les « années folles » en France), peut-elle vivre comme ses aïeules, ne pas pressentir que la condition féminine est en train d’évoluer. Beaucoup des héroïnes de ces nouvelles sentent la nécessité de faire comprendre à leurs seigneurs et maîtres que cette époque est terminée. Elles le font avec élégance, sans tapage majeur, mais avec une efficacité redoutable et réjouissante.
Clarice Lispector excelle à faire entrer le lecteur dans des états à la limite entre la réalité et l’impalpable, dus à un égarement passager, parfois à l’alcool et nous fait ressentir ce moment où l’esprit, tout en étant encore en partie conscient de ce qui l’entoure, s’évade vers des terrains flous.
On peut, sans jouer les cuistres, parler de la magie des mots. Clarice Lispector sait les enchaîner en faisant naître le trouble de la beauté ou des aspérités. De la poésie ? Plus exactement une façon de suggérer en trouvant précisément le mot qui fallait, qui parlait au lecteur du temps où elle écrivait comme au lecteur actuel.
Elle sait aussi pratiquer l’humour et par le rire évoquer rien moins que la valeur d’une vie humaine. Elle est aussi à l’aise dans l’évocation subtile des souffrances des femmes et de leurs modestes luttes que dans la description farcesque et sinistre à la fois d’une fête familiale.
On connaît trop peu encore l’œuvre de la romancière brésilienne. Il faut se précipiter sur cette nouvelle parution pour enfin combler cette lacune : Clarice Lispector est un des auteurs les plus importants du XXème siècle, cela ne fait plus aucun doute quand on referme ces Nouvelles.
Nouvelles. Édition complète, de Clarice Lispector, édition établie pas Benjamin Moser, traduit du portugais (Brésil) par Jacques et Teresa Thiériot, Claudia Poncioni, Didier Lamaison, Sylvie Durastanti, Claude Farny, Geneviève Leibrich et Nicole Biros, éd. des femmes-
Christian Roinat
Clarice Lispector : Nouvelles, édition complète.
Editions des femmes-Antoinette Fouque, 482 p., 23 €
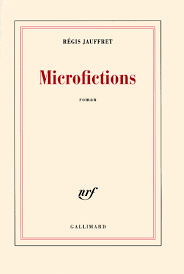
Microfictions, janvier 2018, 1024 pages, 25 €
Ecrivain : Régis Jauffret Edition: Gallimard
500 microfictions dans lesquelles hommes et femmes se racontent, sans pudeur, avec une honnêteté si déconcertante qu’elle donne à ces récits des allures d’aveux libérateurs consignés dans des journaux intimes. C’est alors aux lecteurs, anonymes, de tenir lieu de réceptacle. Mais les confessions sont souvent si sordides, immondes, immorales ou amorales, si froidement haineuses ou si douloureusement intenables qu’on peine à croire y être entrés sans effraction. L’écriture, ciselée, incisive, provocante ou irrévérencieuse accentue encore cette impression de violation d’intimité. Personnelles et singulières, les vies se résument sans condescendance ni pathos excessifs ; chacune d’elles se recroqueville sur deux pages comme le font les narrateurs dans le carcan de leurs aigreurs et obsessions, de leurs âmes perdues, de leurs corps abîmés. Aucun d’eux ne semble pour autant chercher à s’apitoyer sur son sort. Car si l’heure est à l’introspection, la tendance générale est plutôt au constat froid ou au bilan irréversible : les récits se font factuels, précis, réfléchis et distanciés ; logiquement agencés, ils convergent vers leur note finale, toujours assez foudroyante pour susciter le malaise ou l’effroi, et marquer le point de non retour. Poésie, métaphores, tournures colorées, dérision et humour, sur soi ou sur la vie, viennent savamment alléger ou désamorcer la charge émotionnelle.
« Elle avait trouvé l’énergie de descendre acheter la bouteille dont elle vidait le fond entre deux couplets Je suis allé me coucher déçu. Notre enfant prisonnier dans son ventre comme une poire dans une bouteille d’eau-de-vie ».
« Nous vendons la maison avec la vie qui est dedans.
À charge pour l’acheteur de m’endosser comme un costume d’occasion et d’adopter mon existence que je ne saurais trop lui conseiller de démolir à coups de pied au cul ».
« – La voiture a sauté la glissière de sécurité.
La chaleur de l’été dernier avait fait fondre ma raison. J’ai eu la chance de rentrer chez nous après quatre mois de rééducation. Il suffit à Linda de ranger ma chaise roulante dans les hauteurs du cagibi pour me clouer sur place. L’immobilité calme les fous ».
Même si c’est jaune, du bout des dents, nerveusement, de manière forcée ou contrainte, le lecteur se surprend à rire, sinon sourire. Or c’est une gageure exceptionnelle, que de faire rire ou même sourire le lecteur, à propos de destins si atrocement tragiques. C’est néanmoins sans compter sur le talent remarquable de Régis Jauffret, passé maître en la matière. Tous ses personnages, qu’ils soient meurtriers, assassins, suicidaires, suicidés, violeurs, violés, pédophiles, pervers, sadiques, schizophrènes ou psychopathes, mal aimés, frustrés, désespérés, désœuvrés ou névrosés, acteurs, victimes ou spectateurs, se confessent avec un art exemplaire de la distanciation. Chacun d’eux se déleste d’un poids, d’un secret ou d’un fardeau insoutenable. Ils se font ainsi les passeurs de la noirceur humaine sous toutes ses formes, qu’ils déposent entre les mains du lecteur. À lui de faire avec ces condensés de souffrances et de folies, de s’émouvoir, de suffoquer, de s’insurger et d’accorder, ou pas, des circonstances atténuantes.
Tous les sentiments humains, surtout les plus obscurs, les moins avouables, les plus abjects et les plus douloureux sont passés au crible de cette narration aux vertus cathartiques, puisque ces histoires sont fictives, certes, mais pas que. Car l’humanité est assurément capable des pires ignominies, de même qu’elle sait aussi se perdre dans les affres de l’existence…
Christelle D’Hérart-Brocard
(Article paru dans La Cause Littéraire)
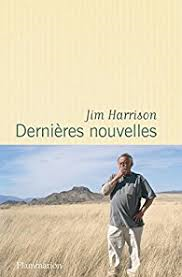
DERNIERES NOUVELLES DE JIM HARRISON
Aucun général ne devrait mourir ailleurs que sur le champ de bataille et aucun écrivain ailleurs qu’à sa table de travail, parce que ce sont les lieux où s’accomplit leur destin. Jim Harrison est mort le 26 mars 2016, comme doivent mourir les écrivains, à son bureau, en train de composer un poème. Il avait soixante-dix-huit ans. Les quantités de nourriture, d’alcool et de tabac qu’il absorba au cours de sa relativement longue existence étaient un défi lancé à toutes les normes diététiques et hygiénistes mises en œuvre dans son pays, puis importées en Europe : « ne pas manger trop gras trop salé trop sucré cinq fruits et légumes par jour à consommer avec modération manger bouger fumer tue ». Mais nous ne sommes pas seulement redevables aux États-Unis de cette litanie déprimante. Nous leur devons également, entre autres choses, l’œuvre de Jim Harrison, qui excellait dans la composition de novellas, des récits plus longs que des nouvelles au sens classique du mot, mais plus courts que des romans ; le plus célèbre étant Légende d’automne. Ces Dernières nouvelles recueillent les trois ultimes récits écrits par Jim Harrison au moment de sa disparition.
L’affaire des Bouddhas hurleurs a fait l’objet d’une prépublication dans l’excellente revue America de François Busnel (la traduction, toujours excellente, de Brice Matthieussent avait subi quelques retouches mineures. On aurait aimé voir reprises en volume les belles illustrations de Karolis Strautniekas). Harrison arrive à se couler aussi bien dans l’esprit d’une fermière du Montana, dont l’existence se déroule de part et d’autre du second conflit mondial, que dans le cerveau riche en obsessions diverses (et typiquement harrisonniennes) de l’inspecteur à la retraite Sunderson, amené à infiltrer une secte zen du Michigan, dirigée par un gourou californien. Les lecteurs qui, pour cause de mauvais esprit ou de cartésianisme impénitent, n’ont ni l’envie ni la volonté de prendre au sérieux cette sagesse millénaire qu’est le zen, penseront à la secte de Mount Baldy, où feu Leonard Cohen avait atterri de 1994 à 1999. Dans les deux cas, les adeptes se nourrissent de riz, de légumes et ne boivent pas d’alcool (le maître, lui, ne subit pas de restrictions, de quelque ordre que ce soit). Grande différence : les membres de la secte décrite par Jim Harrison passent beaucoup de leur temps quotidien à pousser des hurlements (d’où le titre), ce que ne faisait pas Leonard Cohen. On ouvre cet ultime recueil comme on retrouve un vieil ami, dont on pressent ce qu’il va nous dire, autour d’une côte de bœuf et d’une bonne bouteille. On s’installe dans l’univers roboratif de Jim Harrison et on en accepte les lois. Quel est le point commun à des trois récits, où la part de l’autobiographie est à la fois évidente et normale (comme disait Bukowski, on ne rêve pas les rêves de son voisin) ? La liberté, l’envie d’aller, de venir, de manger, de boire, de fumer, de ne rien faire, etc. Une leçon éminemment américaine, venue de ce pays qui a érigé la liberté et le bonheur en valeurs cardinales, malgré des forces adverses de plus en plus virulentes. Message ultime : « […] la seule chose qui comptait dans la vie était de savoir si, oui ou non, on avait l’âme en paix ».
Article paru dans La Cause littéraire
Gilles Banderier
Dernières nouvelles, Jim Harrison
trad. anglais (USA) Brice Matthieussent
Editions Flammarion
300 pages, 21 €
Aucun général ne devrait mourir ailleurs que sur le champ de bataille et aucun écrivain ailleurs qu’à sa table de travail, parce que ce sont les lieux où s’accomplit leur destin. Jim Harrison est mort le 26 mars 2016, comme doivent mourir les écrivains, à son bureau, en train de composer un poème. Il avait soixante-dix-huit ans. Les quantités de nourriture, d’alcool et de tabac qu’il absorba au cours de sa relativement longue existence étaient un défi lancé à toutes les normes diététiques et hygiénistes mises en œuvre dans son pays, puis importées en Europe : « ne pas manger trop gras trop salé trop sucré cinq fruits et légumes par jour à consommer avec modération manger bouger fumer tue ». Mais nous ne sommes pas seulement redevables aux États-Unis de cette litanie déprimante. Nous leur devons également, entre autres choses, l’œuvre de Jim Harrison, qui excellait dans la composition de novellas, des récits plus longs que des nouvelles au sens classique du mot, mais plus courts que des romans ; le plus célèbre étant Légende d’automne. Ces Dernières nouvelles recueillent les trois ultimes récits écrits par Jim Harrison au moment de sa disparition.
L’affaire des Bouddhas hurleurs a fait l’objet d’une prépublication dans l’excellente revue America de François Busnel (la traduction, toujours excellente, de Brice Matthieussent avait subi quelques retouches mineures. On aurait aimé voir reprises en volume les belles illustrations de Karolis Strautniekas). Harrison arrive à se couler aussi bien dans l’esprit d’une fermière du Montana, dont l’existence se déroule de part et d’autre du second conflit mondial, que dans le cerveau riche en obsessions diverses (et typiquement harrisonniennes) de l’inspecteur à la retraite Sunderson, amené à infiltrer une secte zen du Michigan, dirigée par un gourou californien. Les lecteurs qui, pour cause de mauvais esprit ou de cartésianisme impénitent, n’ont ni l’envie ni la volonté de prendre au sérieux cette sagesse millénaire qu’est le zen, penseront à la secte de Mount Baldy, où feu Leonard Cohen avait atterri de 1994 à 1999. Dans les deux cas, les adeptes se nourrissent de riz, de légumes et ne boivent pas d’alcool (le maître, lui, ne subit pas de restrictions, de quelque ordre que ce soit). Grande différence : les membres de la secte décrite par Jim Harrison passent beaucoup de leur temps quotidien à pousser des hurlements (d’où le titre), ce que ne faisait pas Leonard Cohen. On ouvre cet ultime recueil comme on retrouve un vieil ami, dont on pressent ce qu’il va nous dire, autour d’une côte de bœuf et d’une bonne bouteille. On s’installe dans l’univers roboratif de Jim Harrison et on en accepte les lois. Quel est le point commun à des trois récits, où la part de l’autobiographie est à la fois évidente et normale (comme disait Bukowski, on ne rêve pas les rêves de son voisin) ? La liberté, l’envie d’aller, de venir, de manger, de boire, de fumer, de ne rien faire, etc. Une leçon éminemment américaine, venue de ce pays qui a érigé la liberté et le bonheur en valeurs cardinales, malgré des forces adverses de plus en plus virulentes. Message ultime : « […] la seule chose qui comptait dans la vie était de savoir si, oui ou non, on avait l’âme en paix ».
Article paru dans La Cause littéraire
Gilles Banderier
Dernières nouvelles, Jim Harrison
trad. anglais (USA) Brice Matthieussent
Editions Flammarion
300 pages, 21 €

L'empreinte volée
Françoise Cohen
Éditeur : Editions Tituli
Collection / Série : Nouvelles
Françoise Cohen vient de publier son deuxième recueil de nouvelles, L’empreinte volée. Dix nouvelles d’une dizaine de pages chacune, bien collées dans leur couverture bleue, mais qui, bien que reliées à la même tranche, nous entrainent tous azimuts…
« Empreinte volée », c’est le titre (et celui de la dernière nouvelle). Il est aussi paradoxal qu’attachant : une empreinte qui colle au réel, mais qui en même temps s’en arrache, s’envole ou en est volée, sans qu’on s’y attende le moins du monde.
Il serait dommage de raconter les histoires de ce recueil : allusions à de très anciennes lettres qui reprennent vie (Le messager des vieilles nouvelles), dédoublement d’un homme sans mémoire (Tout sur Roberto), identités perdues (L’empreinte volée), retrouvées (L’inconnue de la Pagode), confondues (L’enterrement corse), inventées, fixées… Voici pour l’envol ou le vol, mais ce qui frappe ici également, c’est le contenant : nous sommes en présence d’une grosse boîte fermée, stable.
En lisant, on l’ouvre. S’en échappent alors des foules de folies-même-pas-vraies (mais qui pourraient l’être) qui restent néanmoins toutes fermement retenues par l’immobilité de la boîte. La boîte conserve les empreintes ; Françoise Cohen les fait voler, les éclate ou découpe tout autour d’elles en s’amusant.
Que les inconditionnels de littérature fantastique se méfient, le réel est toujours présent. Que ceux qui craignent la folie se rassurent, elle reste parfaitement maîtrisée.
Le style, à la fois ou successivement, vif, lyrique, ou concis (quand il s’agit d’une réalité constatée), donne le rythme d’une danse à l’ensemble, cependant, les nouvelles s’enchaînent sur le mode de la surprise ; donc, pas de chorégraphie ! Et le lecteur est libre de voler à sa guise les empreintes déjà relevées une fois par l’auteur… Lisez ce livre, où que vous soyez et sans bouger ! Il emporte.
Marianne Brunschwig
Françoise Cohen
Éditeur : Editions Tituli
Collection / Série : Nouvelles
Françoise Cohen vient de publier son deuxième recueil de nouvelles, L’empreinte volée. Dix nouvelles d’une dizaine de pages chacune, bien collées dans leur couverture bleue, mais qui, bien que reliées à la même tranche, nous entrainent tous azimuts…
« Empreinte volée », c’est le titre (et celui de la dernière nouvelle). Il est aussi paradoxal qu’attachant : une empreinte qui colle au réel, mais qui en même temps s’en arrache, s’envole ou en est volée, sans qu’on s’y attende le moins du monde.
Il serait dommage de raconter les histoires de ce recueil : allusions à de très anciennes lettres qui reprennent vie (Le messager des vieilles nouvelles), dédoublement d’un homme sans mémoire (Tout sur Roberto), identités perdues (L’empreinte volée), retrouvées (L’inconnue de la Pagode), confondues (L’enterrement corse), inventées, fixées… Voici pour l’envol ou le vol, mais ce qui frappe ici également, c’est le contenant : nous sommes en présence d’une grosse boîte fermée, stable.
En lisant, on l’ouvre. S’en échappent alors des foules de folies-même-pas-vraies (mais qui pourraient l’être) qui restent néanmoins toutes fermement retenues par l’immobilité de la boîte. La boîte conserve les empreintes ; Françoise Cohen les fait voler, les éclate ou découpe tout autour d’elles en s’amusant.
Que les inconditionnels de littérature fantastique se méfient, le réel est toujours présent. Que ceux qui craignent la folie se rassurent, elle reste parfaitement maîtrisée.
Le style, à la fois ou successivement, vif, lyrique, ou concis (quand il s’agit d’une réalité constatée), donne le rythme d’une danse à l’ensemble, cependant, les nouvelles s’enchaînent sur le mode de la surprise ; donc, pas de chorégraphie ! Et le lecteur est libre de voler à sa guise les empreintes déjà relevées une fois par l’auteur… Lisez ce livre, où que vous soyez et sans bouger ! Il emporte.
Marianne Brunschwig

Reste avec moi de Marie-Hélène Moreau
éd. L'Harmattan, coll. Nouvelles nouvelles, 2017
90 pages, 12 €
Il arrive que les morts croisent les vivants, parfois. Qu’ils les frôlent, les attendent, ou bien les accompagnent. Qu’ils les hantent, aussi. La forme qu’ils prennent, alors, est celle d’un être cher ou bien d’un inconnu, monstrueux, invisible ou encore amical. Un animal... Qu’importe. Ils laissent toujours une trace.
Ils se mêlent à la vie, comme un dernier regret de ne plus être là. Chacune des neuf histoires de ce recueil résonne comme un écho à ce dernier regret.
Marie-Hélène Moreau a occupé d’importantes responsabilités dans le domaine des ressources humaines, en France et à l’international, avant de décider, en 2015, de démarrer une nouvelle vie consacrée à l’écriture. Après plusieurs prix obtenus lors de concours littéraires, quelques publications dans des recueils collectifs, Reste avec moi est son premier ouvrage totalement personnel. Ce recueil de nouvelles concentre les thèmes de prédilection de l’auteur : les ressorts affectifs des personnages et leurs interactions, porté par un regard incisif empreint d’une grande humanité.
Marie-Hélène Moreau est une auteure actuellement publiée dans notre rubrique "La nouvelle de la quinzaine".
François Koltès |

Les Croix des champs
éd. L’Œil d’Or, coll. Fictions, 2015, 144 pages, 14 € Les nouvelles rassemblées dans Les Croix des champs placent un personnage face à l’irréversible : impossibilité de fonder le foyer espéré, de revenir à un projet ou à une ingénuité d’avant-guerre, de s’affranchir de désirs irrépressibles pour l’un et d’une situation d’exploitation pour l’autre, ou encore d’effacer son implication dans la mort pourtant accidentelle d’autrui. L’auteur peint les longues existences dont les jours sont ritualisés par les nécessités rurales ou montagnardes, mais aussi la brutalité de basculements. Ceux-ci peuvent être la conséquence d’une prise de décision, ou l’effet d’un accident. L’auteur ne privilégie pas l’un ou l’autre de ces ressorts narratifs : explorant les existences particulières les plus routinières, il semble vouloir en montrer les singularités et les bifurcations imprévisibles. Contraintes de subsistance et déterminismes sociohistoriques régissent durablement des vies qui sont un jour redéfinies par les contingences : incidents, rencontres, révélations poussent les personnages vers leur vérité intime, et les nouvelles jusqu’à une fin le plus souvent ouverte. C’est dans la relation duale avec une figure antagoniste que vivent la plupart des personnages principaux. Cependant, si l’on considère l’ensemble des personnages figurant dans le recueil, on remarque qu’ils sont peut-être aussi nombreux à mourir sous le coup d’une violence de la nature que sous les coups ou les balles de leurs semblables. La nature est ici toujours sauvage, quoique aménagée par l’industrie des hommes qui y creusent des puits et y abritent des bêtes. Une conjonction entre nature et états d’âme est sensible dans ces nouvelles, sans être de l’ordre de la sensibilité romantique. Les rythmes et les contraintes du quotidien rural s’articulent avec les questionnements et les angoisses, comme avec les tensions relationnelles qui travaillent les personnages ; mais, modestes et rustiques, aussi peu portés à l’introspection qu’à la complaisance, ceux-ci ne se livrent guère aux épanchements lyriques. C’est à peine s’ils parlent. L’auteur, plutôt que de leur donner la parole, semble conduire avec eux une étude de la solitude en en recensant les formes : isolement, sentiment de sa propre différence, vulnérabilité. On ne trouvera dans ces textes ni jugement ni analyse du chemin parcouru par le personnage ; celui-ci n’est prétexte à rien, il est intéressant en lui-même, non parce qu’il serait un sujet problématique, une personnalité exceptionnelle, piquante ou dérangeante, mais parce qu’il est le siège d’émotions authentiques. La nouvelle qui fournit son titre au recueil se distingue cependant des autres à cet égard : elle retrace la vie d’un homme de mauvaise foi, qui se gratifie, en casuiste corrompu, d’une scandaleuse et criminelle complaisance ; mais un lecteur naïf pourrait passer à côté de la condamnation tant elle est implicite. Si nombre de relations dans lesquelles les personnages sont engagés sont conflictuelles, des complicités muettes existent aussi, suscitées par la nécessité du labeur paysan, tues par soumission au cours des choses qui n’a pas laissé l’amour suivre sa pente ; affinités tacites, tendresses plus ou moins avouées structurent l’existence intime de ces personnages simples, et chargés sans y penser d’une expérience humaine intense et – peut-être ne faut-il pas craindre ici de répéter ce mot – authentique. Maëlle Levacher Publié à l'origine dans Lacauselitteraire.fr le 26/06/17 |
Joseph Conrad |

L’associé janvier 2017, trad. anglais G. Jean-Aubry, 86 pages, 2 € Edition: Folio (Gallimard) Le parti pris de cette nouvelle extraite du recueil En marge des marées est en apparence convenu. Un auteur de fictions pour revues traîne son ennui dans le fumoir d’un petit hôtel en bord de mer où un vieil arrimeur a ses habitudes. Peu aimable, celui-ci vitupère contre la naïveté des touristes et la complaisance des mariniers à exploiter « cette histoire à dormir debout » concernant un naufrage passé. Et l’homme habituellement taciturne de livrer sa version des faits. Toute l’affaire, avant de se terminer sur les rochers de la côte, a démarré dans un bureau à Londres où Georges Dunbar, frère du capitaine et propriétaire du bateau le Sagamore s’est associé à Cloete, un américain véreux. Un brave homme influençable, un exécuteur des basses besognes, une épouse frivole et une autre modèle : aucune de ces figures typiques ne manque à l’appel. La physionomie de chacune comme sa psychologie animent des décors un peu miteux de cette Angleterre où on rêve d’autant plus d’argent et d’exotisme que les affaires sont rudes et le ciel plombé. En réalité, la nouvelle interroge sur l’inspiration et l’écriture. D’ailleurs, l’ancien arrimeur ne daigne prêter attention à l’étranger qu’à partir du moment où il sait qu’il exerce le métier d’écrivain. Comment se forme une intrigue, à partir de l’imaginaire ou de la réalité ? La réponse de l’écrivain met en exergue le fond. « Quelquefois, il faut tirer des tas de choses de sa tête, quelquefois rien. Je veux dire que l’histoire n’en vaut pas la peine. C’est de ça que tout dépend ». Or, l’essentiel n’est-il pas au contraire dans la forme ? Car sinon, qu’est-ce qui distinguerait le texte travaillé d’un auteur du récit rapporté oralement par un témoin ? Voilà probablement des questions qui se sont imposées au capitaine Conrad quand il commença à écrire à 32 ans. Embarqué à 17 ans, il dut se passionner, dans tous les ports, pour les confidences de marins et d’aventuriers. Mais combien de ses compagnons furent-ils à partager cette avidité sans pour autant devenir, comme lui, un écrivain de génie ? Sous ses bougonnements, le vieil homme du fumoir soulève donc la question fondamentale du mystère de la création. Son interlocuteur tirera-t-il finalement de sa narration un texte de son cru ? Ainsi, la publication à part de cette nouvelle permettra à ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir l’univers de Conrad et donnera aux lecteurs de ses romans l’envie de se plonger dans les Nouvelles complètes publiées par le même éditeur dans la collection Quarto. Marie-Pierre Fiorentino Publié à l'origine dans Lacauselitteraire.fr le 20/03/17 |
David Bosc |

Relever les déluges, David Bosc
Mars 2017, 96 pages, 12,50 € Edition: Verdier En répondant à la fervente injonction de Rimbaud dans son poème Après le déluge cité en exergue, David Bosc donne d’emblée la double dimension de ce recueil de fictions enjambant les siècles, à la croisée du réel et de l’imaginaire. La métaphore rimbaldienne du déluge renvoyait en effet sans conteste à l’élan révolutionnaire de la Commune, au rêve collectif, tout en pouvant s’interpréter aussi sur un plan esthétique et individuel. Mourir et puis sauter sur son cheval, le précédent livre de l’auteur, attisait « les brûlures des contes » en nous emportant dans les rêves les plus fous d’une héroïne aspirant à « se défaire » pour « donner naissance à autre chose ». Et Relever les déluges est de même animé par un souffle libertaire appelant à la transformation de l’ordre ancien, à la construction d’un autre monde. Bien que s’étalant sur huit siècles, les quatre courts récits qui le composent – dont trois ont déjà été publiés en revue – n’illustrent aucune tendance au progrès social et marquent au contraire l’ébrèchement, l’écroulement au contact du réel de ces aspirations émancipatrices, égalitaires et fraternelles qui parfois érigent de nouvelles prisons desquelles il convient de fuir. Mais si la fête bariolée du carnaval ne peut durer, la liberté de nos rêves s’incarnera toujours dans des palais imaginaires sans cesse reconstruits. Le premier récit nous transporte au pied de Parme assiégée, non dans un simple campement mais dans une véritable ville « avec ses rues, ses places, son église et sa mosquée » élevée « comme par enchantement » par son héros Frédéric de Hohenstaufen surnommé la Stupeur du monde. Avec une écriture érudite et foisonnante, flamboyante, ne boudant pas quelques clins d’œil malicieux, le narrateur de Farid Imperator retrace alors en accéléré la vie fabuleuse de cette figure de légende que Dante vénèrera. Et c’est un Moyen Age de lumières qui se dessine alors sous nos yeux étonnés. Petit-fils de Barberousse, cet orphelin couronné roi de Sicile à quatre ans et livré à lui-même dans une Palerme portuaire, « où passent tous les visages du monde », grandira « comme un agneau parmi les loups » sans se faire dévorer, car accroché à son « bloc de folie ». Polyglotte d’une curiosité insatiable, il n’aura de cesse d’apprendre à l’époque où l’Eglise enseignait « qu’il est doux de ne pas savoir » et il bâtira un vaste empire, réunissant à sa cour, tels les princes de la Renaissance, les plus grands savants et lettrés d’orient et d’occident. Mais cette nouvelle ère s’achèvera en 1248 avec la chute de Victoria, prise par surprise par l’ennemi parmesan. Une cité idéale qui ne disparaîtra pas pour autant de nos rêves. Mirabel donne la parole à un valet de ferme qui nous enivre de son récit d’une langue alerte et gouailleuse, emplie d’une très concrète vitalité. Et nous comprenons peu à peu qu’il s’adresse à ses juges lors de son procès, auquel nous sommes en train d’assister. Après avoir échappé au tremblement de terre de Manosque de 1708 et à la grande peste en 1720, sans compter un très rude hiver, Mirabel voit enfin se rouvrir le ciel. Ces catastrophes ayant aiguisé son désir de jouir de la vie, il décide de changer de condition. Faisant croire qu’il a découvert un trésor, il monte une escroquerie censée le conduire vers « cet autre pays qui est partout quand on est riche », ivre de sa fable autant que de vin. Et s’il sera condamné à l’enfer et au martyr pour avoir « blasphémé l’argent », il aura quand même eu le meilleur de ce trésor – qui, comme dans Le trésor de la guerre d’Espagne de Serge Pey, semble avant tout celui de la poésie. C’est pendant la guerre d’Espagne justement que se situe Le grelot, sublime fugue poétique riche de contrastes éclairant avec sensualité et simplicité la beauté de la nature et du façonnement humain de la matière, comme la chaleur et la noirceur des hommes. Son attachant héros, un maçon de la Mancha plus solidaire que solitaire, connaîtra la désillusion des « utopies déniaisées », à l’image de Josep dans Pas pleurer de Lydie Salvayre. Ne supportant ni l’enfermement ni l’injustice, épris de liberté et d’égalité, Miguel Samper est mu par un élan qui le porte sans cesse à fuir, non pour sauver sa peau mais pour sauver son âme. Car il garde toujours à l’oreille la voix de sa conscience, pure comme le son du grelot de ce chien de « berger des frontières » qui lui portera secours dans cette montagne sauvage où il tombe dans une faille. Construit en aller et retour sur une constante succession de départs, de fuites et d’évasions, le récit commence lors de cette chute. Le héros arrêté dans sa course se défait alors de son histoire auprès de son sauveur : une histoire qui, du départ du foyer paternel à l’enrôlement dans l’armée du front populaire, l’a mené à la désertion, dégoûté par cette « petite inquisition » moyenâgeuse à laquelle elle se livre et « pour faire pièce au salaud que l’on porte en soi ». Une fois rétabli, il reprend son parcours et son histoire, choisissant finalement de rejoindre son armée. Il connaîtra ainsi l’exil collectif des vaincus et le parcage dans le camp d’Argelès puis, après une ultime évasion, il fera à nouveau volte-face pour soutenir ses camarades dans leur misère. Dans Un onagre enfin, le narrateur suit Denis et sa bande d’amis anarchistes qui fêtent à leur manière la nouvelle année 2003. Dans une langue agitée, pétillante et colorée, il nous décrit le joyeux abordage d’un bateau-restaurant dans le port de Marseille puis le feu d’artifice tiré à minuit des collines pour les prisonniers des Baumettes. Entre temps, dans une succession de flashes-back, il remonte à l’origine de leur étonnante coopération. Car Denis est « un onagre d’homme » préférant les libres pâtures et « la chambre particulière » aux manifestations où l’on marche au pas, et s’il aime jouer à en découdre avec l’autorité, il s’enfuit toujours avant que cela ne dégénère. Ce « gosse insolent qui ne baisse pas les yeux » passe l’essentiel de son temps à réaliser et afficher des stickers provocateurs dont les étranges citations tirées des Ecritures appellent à l’étincelle des commencements, à cet échange qui parfois « se maintient, se hausse ». Et pour lui ce soir-là une nouvelle ère commence, puisqu’il réussit à s’éclipser à la faveur de la nuit, arrachant Mathilde à sa meute. Variant habilement son dispositif narratif et donnant ainsi à chacun un relief spécifique accrochant l’attention du lecteur, David Bosc mène tambour battant ces quatre récits d’une tonalité différente. Exaltant cet élan vital s’ouvrant à l’inconnu, ce mouvement même de la liberté abattant toutes les cloisons qui est aussi celui de la poésie, ce recueil d’une magnifique écriture éclaire aussi un monde complexe « qui n’est pas fait tout d’une pièce ». Emmanuelle Caminade Publié à l'origine dans Lacauselitteraire.fr le 04/04/17 |
Edna Blaise |

La pitié ne coûte que dix gourdes, Edna Blaise
C3 éditions, 2016, 53 pages, 3,50 € (250 HTG). Depuis près de 100 ans l’île d’Haïti s’est révélée terre de haute littérature, bien au-delà des générations et des écoles. Poésie, roman, théâtre, contes ou nouvelles… les auteurs haïtiens, sans vraiment faire « école », sont présents quasiment dans tous les coins et recoins de la littérature. Haïti terre littéraire où écrire est la chose la plus partagée ? Visiblement oui. Mystère du climat, réponse aux souffrances imposées par la nature et l’histoire ? Sans doute un peu de tout cela. En voilà une nouvelle preuve avec ces nouvelles d’une auteure de 23 ans qui publie ici son premier livre : Edna Blaise. Un volume aussi court (une cinquantaine de pages) que prometteur. En quatre nouvelles nous découvrons une ironie mêlée d’onirisme et d’une élégance cruelle qui fait mouche. Tout cela en nous parlant, mine de rien, de la réalité haïtienne. Dans Le résultat de mes tests, des symptômes qui pourraient être inquiétants révèlent la plus improbable des maladies. C’est l’impossibilité de se connaître et de se reconnaître qui est le fil du Rendez-vous, semblant nous dire que depuis janvier 2010, à Jacmel et ailleurs, il y a des fois où le présent rend le passé illisible. L’ironie s’y fait ici cruelle et troublante. Inquiétante même. C’est une certaine tendresse que l’on peut aussi percevoir dans Edna, même si ce témoignage d’un père qui observe sa fille porte bien des marques d’incompréhension, de tension, d’agacements… et d’estime. La dernière nouvelle, qui donne son titre au recueil, La pitié ne coûte que dix gourdes, aux accents de conte d’Andersen des Caraïbes, s’arrête sur la violence quotidienne faite aux enfants, aux ambiguïtés de la charité qui leur abandonne dix gourdes (la monnaie haïtienne, un petit peu plus de 10 centimes d’euro). Il a dans cette écriture déjà un ton, qui se cherche et se trouve, qui nous donne envie d’en lire plus. La créolité haïtienne n’a pas fini de nous séduire, sans doute par cette universalité dont la littérature peut parer le local. Mais au fond, il se pourrait bien que littérature soit l’autre nom de Haïti. Edna Blaise est par ailleurs chroniqueuse régulière du principal quotidien haïtien, le National (exemple d’une de ses chroniques, Un coup de fil aux aïeux). C’est un éditeur du cru qui nous propose cette découverte, les éditions C3. Fondée en 2011, la maison a déjà un beau catalogue ouvert à la poésie, au roman, aux essais, aux nouvelles… et qui accueille aussi bien des plumes illustres reconnues jusque chez nous (Lyonel Trouillot, Louis Philippe Dalembert, René Depestre ou Gary Victor) que de nouveaux auteurs. Si vous n’avez pas le loisir de faire le voyage, vous pouvez passer par le projet de l’association LEVE pour vous les procurer. Marc Ossorguine Publié à l'origine dans Lacauselitteraire.fr le 24/05/17 |
Sam Sheppard |
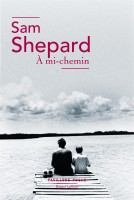
A Mi-Chemin, Sam Shepard
A Mi-Chemin, août 2016, trad. américain Bernard Cohen, 202 pages, 8 € Edition: Pavillons (Poche) Nul doute que Sam Shepard soit un nouvelliste exceptionnel. On entend dans ses récits la paternité de Raymond Carver par son art d’une sobriété époustouflante et celle du Montana, dans sa passion dévorante pour la nature et les grands espaces. Les nouvelles rassemblées ici condensent son talent de conteur de coupes de vie, serties dans des moments, des situations improbables. Ce recueil nous offre 18 nouvelles courtes dans lesquelles, avec une énergie et une tension permanentes, Shepard brosse un monde peuplé d’hommes rudes et fiers, de femmes qui ne le sont pas moins, dans des cadres naturels sauvages et solitaires. Un monde où les animaux, chevaux, chiens, chèvres, tiennent une place éminente aux côtés des humains, une place où ils sont des êtres à part entière, nobles et sacrés. Ainsi dès la première nouvelle, Le Guérisseur, cette scène splendide avec un cheval indomptable : « Sur son dos, les muscles ondulaient comme des couleuvres. Des coulées de sueur noire sortaient de sa crinière. J’avais dans le nez l’odeur de la peur, aussi forte que celle d’un rat mort dans une mangeoire. Peur animale et peur humaine, entremêlées ». Le monde de Shepard c’est surtout celui de la divine nature. Car Dieu n’est rien d’autre chez lui que la beauté du monde, son chant sacré, sa parfaite unité, sa sublime harmonie. Ecoutez ce chant du monde : « J’ai observé la nuit tomber, les hiboux s’installer dans le grand eucalyptus et entamer leur veille, à l’affût du moindre bruissement dans les plantes du jardin. […] J’ai jeté la tête en arrière, la bouche ouverte sur le ciel noir, et c’est l’explosion géante de la voie lactée qui a dû tirer de moi un grand cri hilare, comme si on avait pincé un nerf tout le long de mon échine. Je riais avec mes dents, avec ma peau. J’ai entendu mon père sortir sur le perron et m’appeler, mais je n’ai pas répondu, et j’ai continué à me balancer en silence. A cet instant, j’ai vu exactement d’où je venais et jusqu’où je m’en irais ». Les nouvelles de Sam Shepard palpitent d’humanité, de compassion, des grands vents de l’universel. Eclatants brins de vie qui surgissent dans les lieux, les moments les plus inattendus, avec des gens qui ne le sont pas moins. Ainsi dans ce fast food minable, avec des petits serveurs surprenants : « Au-dessus des ailes de poulet fumantes, il y a un petit carton avec une phrase écrite à la main dessus : LA VIE, C’EST CE QUI VOUS ARRIVE PENDANT QUE VOUS RÊVIEZ DE FAIRE AUTRE CHOSE. L’écriteau tout taché se balance lentement dans la lumière orange des rampes chauffantes. Une musique de fond apocalyptique geint dans des hauts parleurs bien cachés. Un petit gars tout anémique est embusqué derrière le comptoir, sa casquette enfoncée sur le crâne et deux grandes oreilles rosées pointant sur les côtés, chacune autant chargée d’anneaux qu’une tringle à rideaux ». On va ainsi, avec la voix grave de Shepard parfaitement restituée par Bernard Cohen, sur des chemins de solitude, d’inquiétude, d’humanité enfin. Un livre qui rêve du Paradis, une lecture qui s’impose. Leon-Marc Levy Publié à l'origine dans Lacauselitteraire.fr le 18/05/17 |
Jack London |
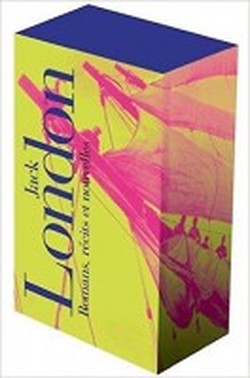
Jack London, Oeuvres
2 tomes, 110 € les deux volumes, Octobre 2016 Ecrivain(s): Jack London Edition: La Pléiade Gallimard Jean-Marie Rouart, dans un texte intitulé « Je demandais aux livres : “Comment fait-on pour vivre, pour aimer, pour être heureux ?” » (paru dans la revue Commentaire en 2015), écrit ceci : « Je n’imaginais pas que j’éprouverais autant d’émotions en remettant mes pas dans des coups de foudre parfois anciens. Soudain je retrouvai intacte mon ancienne ferveur en relisant […] le début du Peuple de l’abîme de Jack London ». Reprenons ce début, tel qu’il est traduit par Véronique Béghain, dans le volume de la Pléiade : « Mais c’est impossible, vous savez », me dirent des amis auprès desquels je venais chercher de l’aide pour m’immerger dans l’East End londonien. « Vous auriez intérêt à demander un guide à la police », ajoutèrent-ils, après réflexion, s’efforçant non sans mal de s’adapter aux mécanismes psychologiques du fou venu les trouver avec plus de références que de cervelle. « Je ne veux pas voir la police, protestai-je. Ce que je veux, c’est plonger dans l’East End et voir ce qui s’y passe par moi-même. Je veux savoir comment ces gens y vivent, pourquoi ils vivent là, et l’avenir qu’ils y voient. En bref, je vais moi-même m’y installer. – Vous n’y pensez pas ! » répliquèrent-ils, unanimes, avec une moue désapprobatrice non dissimulée. « Ma parole, on dit qu’à certains endroits la vie d’un homme ne vaut pas un sou. – C’est exactement là que je veux aller, m’écriai-je. – C’est impossible, vous savez, me répondit-on immanquablement. – Ce n’est pas pour ça que je suis venu vous voir », répondis-je avec brusquerie, quelque peu agacé par leur incompréhension. « Je ne suis pas d’ici et j’aurais besoin que vous me disiez ce que vous savez de l’East End afin de pouvoir partir de quelque chose. – Mais nous ne savons rien de l’East End. C’est quelque part par là-bas ». Sur quoi ils firent un geste vague en direction de l’endroit où l’on peut très occasionnellement voir le soleil se lever. Christian Topalov dans « Raconter ou compter ? L’enquête de Charles Booth sur l’East End de Londres (1886-1889) » (cf. la revue Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2004) rappelle ainsi l’entreprise de London : « Jack London (1876-1916) […] était occasionnellement journaliste en même temps que romancier. Il débarqua des États-Unis en 1902 et obtint une commande d’un éditeur new-yorkais pour enquêter sur la misère à Londres. […] [I]l se déguisa en ouvrier misérable pour “s’engloutir dans l’East End de Londres” et publia son récit par épisodes dans Wilshire’s Magazine, un petit magazine socialiste de New York, puis sous la forme d’un livre intitulé The People of the Abyss (1903) ». Et Véronique Béghain de synthétiser, de manière circonstanciée, dans la notice consacrée à cet ouvrage : « […] la forme de cette enquête dans les marges du Londres de l’aube du XXe siècle, mêlant témoignages, sources documentaires, tentative d’identification des origines économiques, sociales et politiques du mal, mais aussi récits, portraits et descriptions non dénués d’emprunts à l’imaginaire des bas-fonds qui lui est contemporain, en fait un objet hybride qui se lit à la fois comme un travail sociologique pionnier préfigurant des méthodes d’enquête de terrain qui trouveront leur formalisation dans les travaux de l’École de Chicago et comme un récit autobiographique appelé à trouver divers prolongements dans les fictions à venir que sont notamment Le Talon de fer et Martin Eden, tout en constituant une première amorce de taille des incursions de London sur le terrain de l’essai politique ». Matthieu Gosztola Publié à l'origine dans Lacauselitteraire.fr le 22/04/17 |
Cécile-Marie Hadrien |
L'écriture de Cécile-Marie Hadrien est une rivière qui s'écoule sur la page des mémoires, charriant les ordres et les désordres de l'agitation mentale.
Judicieusement adopté, le style familier, de langue parlée, intensifié par les fractures incessantes des phrases brèves, cassantes, emporte la lecture dans les sauts, sursauts, concordances et discordances, allers et retours, échappées et enfermements, en perpétuelles ruptures, de l'esprit. Mais plus que tout, la rareté tient en ce rendu sensoriel, incarné, des émotions, qui ne laisse aucune chance au lecteur de s'échapper, identifié, saisi, par les aléas de l'âme, aspiré dans les battements d'un cœur qui n'est plus sien. Jean-Louis Gardette Les petites filles rêvent de chevaux, de Cécile-Marie Hadrien Éditions Paul & Mike, 2016 |
Chico Buarque |
Francisco fils d’un grand critique littéraire à São Paulo, vit entouré des livres de son père dans toutes les pièces de la maison, livres qu’il consulte en cachette. Il vit aussi dans l’ombre de son grand frère, séducteur invétéré dont il récupère les conquêtes quand elles sont rejetées. Il cherche en vain à gagner la reconnaissance de ce père qui ne regarde que son aîné. Or il découvre dans un livre une lettre datée de 1931, Berlin, d’une certaine Anna qui s’adresse à son père et parle de leur fils âgé d’un an, son demi-frère donc. Il va alors de façon compulsive et obsessionnelle mener l’enquête, sur un rythme endiablé que le style vif de l’auteur rend à merveille. Il échafaude des scénarios extravagants, rencontre un pianiste venu s’installer au Brésil, fuyant l’Allemagne et la période nazie, qui lui avouera avoir connu comme voisins d’immeuble Anna et son fils à Berlin. Il se lie d’amitié avec le fils du pianiste qui se révèle un beau profiteur, il perd son travail, et surtout il perd son ami d’enfance et son grand frère, tous deux happés par la police de la dictature, et qui ne reviendront jamais. A la mort du père succéderont des années de solitude avec sa mère dévorée par ses chagrins, puis de solitude tout court au milieu des livres et finalement il y aura le voyage à Berlin, en 2013 pour rencontrer ce demi-frère qui a bien des airs de famille, mais il ne le découvrira que par le biais d’images d’archives. Remarquable roman où contrastent l’humour, la dérision, le ton futile et désinvolte, la noirceur des événements et la mise en parallèle discrète des années sombres du nazisme en Europe et la longue période sinistre de la dictature au Brésil. Surtout en sachant la part d’autobiographie assumée de ce roman, on ressent beaucoup d’empathie pour le héros qui se débat pour vivre avec une vigueur remarquable en proie à ses fantasmes, son imagination débordante et la réalité de son quotidien souvent cruelle. Voilà un roman qu’il ne faut pas laisser échapper. Martine Roinat Le frère allemand de Chico Buarque Éditions Gallimard, 2016 |
Françoise Cohen |
« Ne vous fiez pas aux apparences, Ana, ce qui semble insignifiant ne l’est pas forcément », c’est le conseil de l’observateur dans Le collier de l’île de Bora Bora, l’avant-dernière nouvelle du recueil de Françoise Cohen. Car mine de rien Ana se dévoile, toujours la même et toujours une autre dans ses dix aventures qu’elle nous raconte ici. Elle se cache, elle se trompe, elle se retrouve changée, on la découvre tremblante sous un linge de sculpteur (Ana et la statue), évanouie, ressuscitée, gamine ou épouse ennuyée (Jour de pluie), résumée dans une paire d’yeux verts (Dernières images avant la nuit). Un lecteur sceptique pourrait lui crier, « Pose-toi à la fin ! Le fantastique je n’y crois pas, moi, je ne crois que ce que je vois ! » Comment se fait- il alors qu’il lise le livre d’un trait ? C’est que Françoise Cohen sait l’emmener à peine un petit peu ailleurs, avec tact et persuasion. C’est que le style de Françoise Cohen n’a pas d’étiquette, que la vie d’Ana donne à voir juste ce qu’il faut d’invisible pour élargir le champ de vision du plus sceptique des lecteurs. C’est bien la clé d’écriture donnée par l’observateur du collier de l’ile de Bora Bora : faisons attention à ce que qui se passe et la vie devient différente. D’ailleurs, loin d’être supérieure au lecteur, l’héroïne sait parfois se mettre en retrait et se laisser surprendre par d’autres vies que la sienne (Ultime feuille de glycine qui parle magnifiquement à la fois de la force de l’amitié et de l’impuissance humaine…) Ne vous fiez pas aux apparences, n’écoutez pas vos préjugés. Vous n’échapperez pas à la séduction de cette lecture. Dix nouvelles. Courtes. Mais qui marquent. Marianne Brunschwig http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=9782140001734 Ana-Chroniques de la nuit et du jour de Françoise Cohen Éditions L’Harmattan, 2016 |
Sergio Olguin |
Veronica Rosenthal, journaliste trentenaire, libre, aimant les hommes et le bourbon, découvre un fait divers piquant sa curiosité : le suicide d’un conducteur de train s’accusant d’avoir écrasé sur les voies plusieurs personnes. Elle commence son travail d’investigation, nous entraîne dans les bidonvilles de Buenos Aires, là où des mafieux recrutent des gamins pauvres pour des sauts de la mort, de nuit, sur les voies ferrées, assurant de juteux paris clandestins. Elle nous fait également plonger dans ses ébats amoureux très violents et désespérés avec Lucio, marié, père de famille, conducteur de trains et sa première source au commencement de ses recherches. Autour d’elle gravitent des personnages touchants, les gamins des paris, Rafaël un ex- junkie qui fait tout pour récupérer sa femme et sa fille et qui se révèlera très courageux et des gens inquiétants, politiques et mafieux corrompus. Voilà un roman intéressant, à la limite du documentaire tout au long des déambulations de Veronica de bars branchés et quartiers chics aux « barrios » populaires et très miséreux de la capitale. Mais il ne faut pas non plus occulter l’analyse fouillée des personnages, leur tristesse profonde voire leur mal de vivre qui émeut le lecteur et l’intrigue rondement menée qui fait froid dans le dos. Martine Roinat La fragilité des corps de Sergio Olguin Éditions Actes Sud, 2015 |
Derek Munn |
Prix Place aux nouvelles/Lauzerte 2015
http://www.placeauxnouvelles.fr/Dix-huit nouvelles qui saisissent des instants de vie ordinaire, instants de transitions, de crise, de doute. Des couples, qui vont bien, qui vont moins bien, des solitudes, des relations entre parents et enfants, le harcèlement du travail, le stress du chômage. Les difficultés de dire et de vivre dans la société actuelle. Certaines résistent, continuent, d’autres basculent dans la folie, refuge extrême. On se laisse porter en douceur avec la sensation qu’à tout moment une chute vertigineuse est possible. Ces nouvelles dépeignent avec justesse l'équilibre précaire de la vie. Derek Munn vit à Bordeaux. Il a publié Mon cri de Tarzan, Léo Scheer/Laureli, 2012 ; Un paysage ordinaire, Christophe Lucquin éditeur, 2014 et des nouvelles et textes courts dans les revues Rue Saint Ambroise, Borborygmes, Dissonances, Pr'Ose !, Gelée rouge, Coaltar, Aka, Le cahiers d'Adèle, Ce qui reste, Sarrazine.
Un paysage ordinaire de Derek Munn Édition Chistophe Lucquin |
Alice Munro |
Alice Munro, canadienne, auteur de nouvelles si « bonnes » qu’elle a obtenu le prix Nobel de littérature en 2013, a écrit entre autres un recueil que je viens de terminer L’amour d’une honnête femme. On retrouve sa patte dans chacun de ces récits, ficelés comme des romans miniatures (une cinquantaine de pages chacun), où tout l’univers est brossé d’une facette de quotidien qu’elle a l’art de grossir et polir. On peut difficilement ne pas être pris par son art du récit. Les huit nouvelles de L’amour d’une honnête femme, ont fait encore une fois mollir mon esprit critique : j’admire. Alors il faut relire et se demander comment elle fait. Chaque fois elle part d’une situation calme, d’un rien de tous les jours qui nous laisse le temps de croiser les jambes dans notre fauteuil. Un temps généreux pour l’installation. Et puis peu à peu le rien prend forme, devient quelque chose puis plusieurs choses. D’un personnage en naît un autre puis un troisième puis beaucoup d’autres et chacun vit à en perdre le rythme, retraversant dans tous les sens les couches du temps passé présent futur, présent futur passé, futur…Cela dépend. Par exemple dans Le rêve de ma mère : « Tout était calme…. Cependant quelque chose détonnait. Il y avait une erreur dans cette scène » Je brûle de raconter, mais je ne dirai rien ou plutôt seulement ceci : Alice Munro excelle à pointer les erreurs. Dans Les enfants restent, une erreur d’amour, un bref adultère devient poignant parce que l’auteur a l’idée géniale de les raconter en parallèle de la pièce de théâtre Eurydice d’Anouilh – mise en abîme, questions, miroir ? L’histoire banale prend alors des allures de mythe à mesure que le mythe devient une chose banale et même familière aux enfants : « Ce n’était pas Orphée ? Papa disait que c’était lui. » (page 150). La place donnée aux enfants dans ces nouvelles est d’ailleurs très intéressante. Les petits n’ont rien à voir avec les enfants ordinaires, ils sont plutôt des « richesses », des « potentiels » en devenir et j’ai parfois eu le vertige en devinant chez eux des traits d’adultes ou de vieillards…Un peu comme devant certains tableaux de la renaissance italienne où l’enfant Jésus arbore une tête de vieux monsieur. Ce qui m’a plu dans ce recueil, peut être plus marqué que dans d’autres, c’est le discret croche-pied qu’elle fait aux pieds du fauteuil du lecteur. Elle nous installe, nous fait tomber et nous ramasse. Laissons-nous faire. L’amour d’une honnête femme d’Alice Munro Editions Points, traduit de l’anglais (Canada) par Geneviève Doze, 9,70 €. |
Sylvie Dubin |
Après sa galerie de femmes*, S. Dubin propose au lecteur 14 nouvelles pour lui faire parcourir « l’échelle de Richter des tremblements d’imagination », selon l’expression de Myriam Boucharenc qui a rédigé la préface du recueil. Il s’agit en effet de montrer comment un petit accroc dans le tissu des jours ordinaires peut faire vaciller tout l’édifice rationnel que chacun construit patiemment, remettre en cause la stabilité des choses et jusqu’à la réalité même. Le recueil explore ainsi une série d’écarts – de langage, de logique, de morale – tout en jouant avec les genres et les codes littéraires : fantastique, policier, science-fiction, fable ou parabole, chaque texte interroge aussi notre rapport à la lecture. Car l’auteur s’amuse à créer un espace de jeu où l’on est invité à faire preuve de perspicacité. Résoudre des énigmes, déchiffrer les références, décoder ce qui s’écrit à l’envers du texte, « derrière le rideau » : le lecteur est un enquêteur. Avec son lot de miroirs, de doubles, de cercles et de labyrinthes, on se trouve bien dans un univers fantastique ou de réalisme magique, comme le signalent les clins d’œil à Borges et Cortazar, dans cette bibliothèque infinie qui sous-tend le livre. Pas d’érudition pédante, cependant : si l’auteur livre métaphoriquement quelques secrets d’écriture et quelques leçons de lecture, ce n’est pas sans humour, lequel est aussi une forme d’écart… * Selon elles (Prix de la Nouvelle de la Ville d’Angers), paru aux éditions Siloë en 2010. Notons que Sylvie Dubin a publié deux textes dans la revue Rue Saint Ambroise : « Libre-service », en avril 2014 et « Trois p’tits chats et caetera », en mars 2013. L’empouse et autres écarts de Sylvie Dubin Editions Paul & Mike 240 p., 15 € |
Roberto Bolaño |
La torture ordinaire de l’écrivain paranoïaqueB, écrivain encore obscur, brosse dans son premier roman un portrait satirique de A, écrivain et critique reconnu. Quand le roman paraît, A en fait une critique élogieuse et influente. Les doutes et le remords assaillent B. En effet, A s’est peut-être reconnu dans le personnage ridicule que B a fait de lui. Quel but inavouable poursuit-il en défendant l’œuvre de B ? Les narrateurs d’Appels Téléphoniques sont écrivains. Ils évoluent dans un quotidien instable économiquement et émotionnellement. Ils luttent pour faire valoir leurs écrits. Ils se nomment B ou Belano, offrant de l’auteur un reflet déformé, distordu à l’instar du K de Kafka auquel on ne peut que penser en traversant ces quelques nouvelles, avec un sentiment d’inconfort et une jubilation croissants. Car ces écrivains en côtoient d’autres, lesquels sont mieux lotis ou non, parfois jaloux et malveillants (leur éventuelle bienveillance n’étant jamais acquise). Beaucoup souffrent d’un sentiment de persécution, quand ils ne sont pas carrément fous (à se pendre). Certains sont insaisissables, difficiles à joindre au téléphone ou à rencontrer. Lorsque les rencontres se produisent, elles donnent lieu à des malentendus, des brouilles, jusqu’à la peur d’un assassinat vengeur. Ainsi se produit, par un effet de mise en abîme, une démultiplication fictionnelle obsessive de l’écrivain dans son rapport ambivalent et torturé à lui-même, ses avatars étant plus ou moins doués et fortunés : les revers de fortune et chutes de popularité sont toujours à craindre dans ce métier à haut risque. Le pire ennemi de l’écrivain, Bolaño nous le démontre avec maestria, n’est nul autre que lui-même. Cécile-Marie HADRIEN Appels Téléphoniques de Roberto Bolaño Editions Christian Bourgois, 2008 Prix : 6,70 euros |
SELVA ALMADA |
Comment raconter la violence faite aux femmes sans sombrer dans le mélodrame ou le sensationnalisme ? Comment trouver les mots justes sans patauger dans le pathos ? Comment convaincre et émouvoir sur de réelles tragédies reléguées par la société à la rubrique des faits divers sordides ? C’est le tour de force de la talentueuse Selva Almada qui va remonter le temps jusqu’aux années 80, reprendre l’enquête sur trois meurtres jamais élucidés de jeunes femmes, Andrea 19 ans, Maria Luisa 15 ans et Sarita 20 ans. Tout commence pour Selva par l’annonce à la radio du meurtre d’Andrea dans un village voisin du sien, elle n’a alors que 13 ans mais prend conscience de l’horreur et gardera le souvenir de cette jeune fille pendant vingt ans, jusqu’au moment où elle commencera ses investigations et jettera sur le papier les résultats de son enquête. La romancière se déplace, rencontre parents et amis des victimes, échange avec une voyante, découvre à l’occasion d’autres meurtres plus récents, nous dévoile pudiquement un monde de machos jaloux, possessifs et violents, sans jamais se laisser aller à un féminisme outrancier. Elle tente de reconstituer les faits avec rigueur, s’accroche aux témoins parfois récalcitrants, les force par son opiniâtreté à lui répondre, à interroger leur mémoire et à cerner au plus près la vérité. En décrivant simplement les faits, les réactions des gens, elle dénonce l’injustice subie par ces jeunes femmes, dans cette mort violente et prématurée, et parfois dans leur réputation salie par des mensonges. Il en ressort un livre bouleversant, très subtil, terrible et puissant, qui traite à la fois une thématique éternelle et universelle, la violence faite aux femmes, et qui présente un état des lieux effrayant sur la réalité actuelle des provinces argentines. Martine Roinat Les Jeunes Mortes de Selva Almada Editions Métailié 2015 144 pages, 17 euros |
DOMINIQUE PASCAUD |
Employé dans un hôtel de province, une jeune fille a le sentiment de ne pas exister. face à un père qui ne lui parle de rien et des patrons qui la dégoûtent, Louise se réfugie dans ce qu'elle sait faire : servir les petits déjeuners, débarrasser les tables, récurer les chambres. Pour se sentir un peu vivante, il y a les caresses de Marc. Et puis, pendant ses pauses, la fumée des cigarettes qui la remplit. Elle n'est pas de ceux qui s'épuisent à rêver leur vie, ou plutôt elle a des rêves modestes, des espoirs de chambres d'hôte, avoir un hôtel à soi près de la colline aux mimosas. Mais un jour, une équipe de tournage s'installe à l’hôtel. Il se passe enfin quelque chose. sans savoir pourquoi, Louise va plonger dans un rêve de gloire qui n'était pas le sien et sa vie va s'en trouver bouleversée. Figurante de Dominique Pascaud Editions de La Martinière 2015 Dominique Pascaud est né en 1976 à Villeneuve sur Lot. Après des études d'arts plastiques à Bordeaux, il obtient le diplôme des Beaux-Arts de Paris en 2001. Parallèlement, il écrit et compose de la musique et sort plusieurs albums auto-produits. Il collabore également avec d'autres artistes sur scène. Il a publié plusieurs nouvelles dans Rue Saint Ambroise. Professeur de dessin, il vit et travaille à Paris.
|
ADRIANA LANGER |
Adriana Langer, nouvelliste remarquée dans nos pages, mais aussi publiée dans Ravages ou encore Moebius, fait paraître, aux Editions La Providence, Ne respirez pas : un recueil de nouvelles inspirées de son univers professionnel (elle exerce le métier de radiologue).
Son portrait |
|